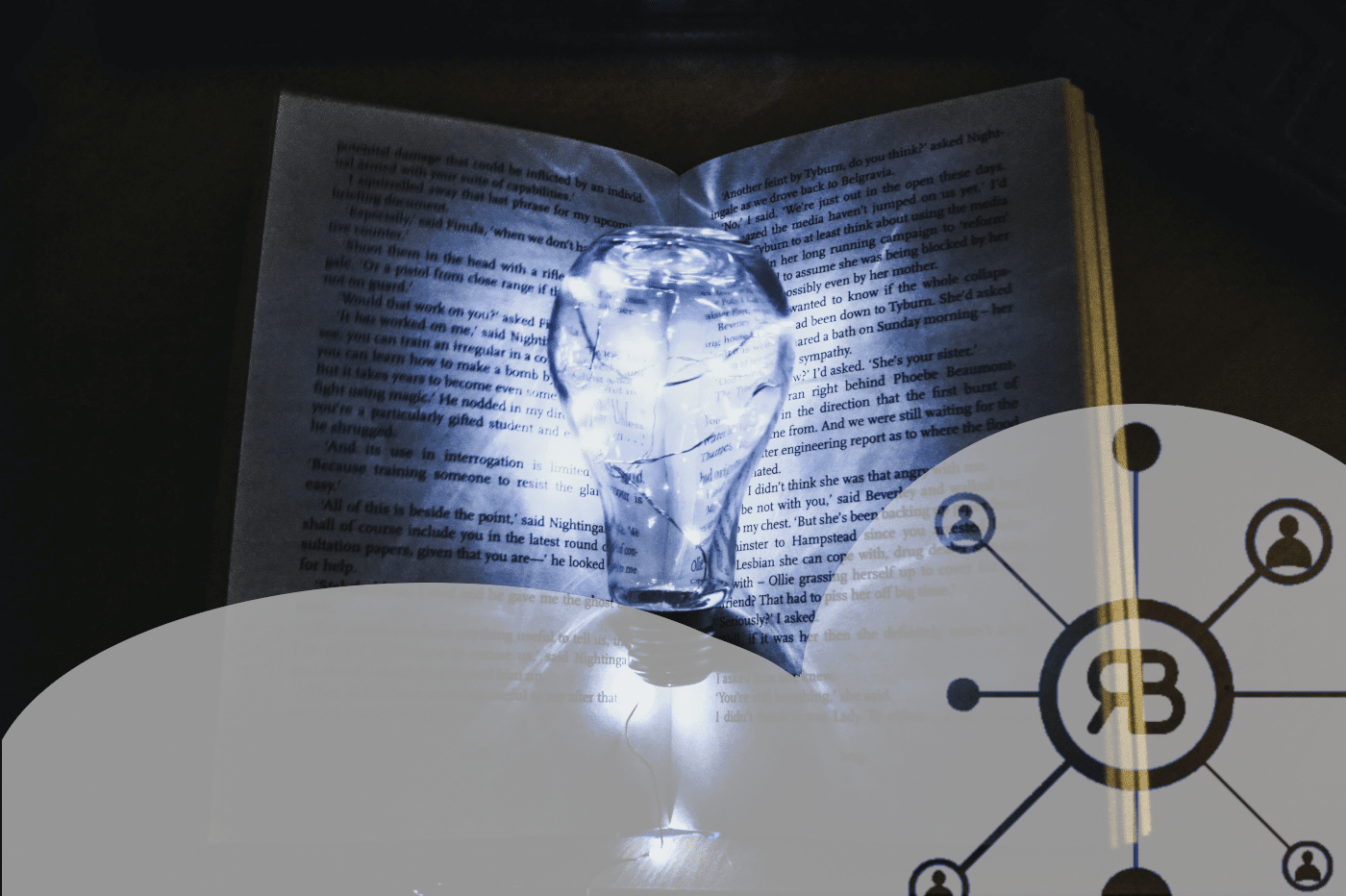Il y a dans les mots une étrange promesse. Un texte bien tourné engage, oriente, déplace. Il ne se contente pas de transmettre de l’information : il produit de l’effet, il agit. Vous le savez et c’est ce que toute marque a compris, en mimant les ressorts du discours narratif, du manifeste ou du manifeste inversé. Pourtant, à mesure que les générateurs textuels inondent les canaux numériques d’un flux continu de contenus sans auteurs, cette promesse semble avoir été trahie. Les textes disent, mais ne parlent plus. Ils remplissent les pages, sans habiter le lieu du langage. Ils annoncent, sans poser d’acte. Et les stratégies éditoriales, si l’on n’y prend garde, s’alignent sur ce silence bavard.
L’essor des IA génératives marque moins une rupture technique qu’un déplacement du lieu d’énonciation. Ce qui est menacé, ce n’est pas la quantité de texte ni sa fluidité apparente, mais la capacité même du langage à faire événement, à engager une subjectivité, à assumer une position, à construire un monde. Le problème n’est donc pas celui de la génération, mais de la signification. Et par-delà, de la performativité stratégique : que reste-t-il de l’autorité d’une voix quand celle-ci peut être simulée à l’infini ?
La tentation est grande, dans ce contexte, de s’en remettre aux métriques, aux prompts optimisés, aux architectures d’automatisation éditoriale. Mais cette fuite en avant occulte une question plus fondamentale, à la fois philosophique et éminemment opérationnelle : comment garantir qu’un discours (même assisté par IA) porte encore une intention, incarne une position, et produise une transformation réelle ?
C’est cette interrogation que cet article se propose d’explorer. Non pour condamner l’automatisation, mais pour reconstruire une écologie du discours, où l’on distingue à nouveau entre le langage habité et le texte vide, entre la parole située et l’énoncé désancré. En croisant les apports de J.L. Austin, Nishida, Ricœur, Kierkegaard, mais aussi ceux des designers, stratégistes et UX writers les plus attentifs à la cohérence sémantique, nous interrogerons la manière dont une entreprise peut, aujourd’hui, orienter sa production de contenu vers un lieu de performativité stratégique.
I. De la génération à l’énonciation : langage sans sujet et performativité en défaut
A) La confusion entre générer et parler : qu’est-ce qu’un contenu qui dit quelque chose ?
Comment distinguer un contenu généré automatiquement d’un contenu qui engage réellement une parole stratégique ?
À première vue, tout contenu textuel “dit” quelque chose. Il informe, conseille, guide ou suggère. Les plateformes d’IA générative renforcent cette impression en produisant à la chaîne des textes parfaitement structurés, polis, parfois même persuasifs. Pourtant, une intuition résiste : quelque chose manque. Ce que ces textes génèrent, ce n’est pas une parole, mais un flux scripté, une suite d’énoncés sans voix, sans ancrage, sans sujet. Ce n’est pas tant qu’ils soient mal écrits, mais plutôt qu’ils ne parlent pas. Ils décrivent sans s’engager, informent sans exister, remplissent sans relier. C’est là que commence la confusion entre générer et parler.
La prolifération de ces contenus générés par IA (prompts bien calibrés, SEO-friendly, mais sans auteur identifiable) transforme insidieusement le langage en matière première automatisable. L’illusion du sens naît d’une cohérence grammaticale et d’une variété stylistique, mais sans qu’aucune subjectivité ne s’expose. L’absence de locuteur réel, de responsabilité énonciative, de posture affirmée, mine le pouvoir symbolique du texte. Comme l’écrit Jacques Ellul dans La parole humiliée, le langage perd sa fonction vitale lorsqu’il devient instrumentalisé au service d’une efficacité externe, ici, celle de l’automatisation narrative.
Ce glissement est loin d’être anodin pour le marketing. Un contenu qui ne dit rien, même s’il est fluide et bien structuré, n’incarne aucune stratégie. Il ne porte ni vision, ni différence, ni autorité. En ce sens, la génération automatisée devient une production de texte sans intention, un texte plat, désengagé, reproductible à l’infini. Et dans un monde saturé de discours, c’est précisément ce qui le rend invisible. Karl Weick l’a démontré : dans les organisations, le sens ne précède pas le langage, il en découle. Or vous le savez parfaitement, un contenu qui ne fait pas sens n’est pas seulement inefficace : il est inopérant.
Ainsi, il ne suffit donc pas d’alimenter un CMS ou une newsletter pour dire quelque chose. Encore faut-il que le langage soit situé, que l’énoncé devienne parole, au sens qu’Austin lui confère : un acte de langage, qui engage un sujet dans un monde, face à un autre. Un article généré peut-il alors dire “je” sans auteur ? Peut-il promettre sans voix ? Peut-il affirmer sans position ? La réponse, bien souvent, est non. Ce que l’on produit alors, c’est du bruit, du contenu sans fonction performative, une suite de mots sans territoire.
Le danger stratégique est double. D’une part, on perd l’ethos de marque, ce socle immatériel mais décisif qui distingue une voix incarnée d’un simple flux algorithmique. L’automatisation sans intention désubstantialise l’identité éditoriale : la marque ne parle plus depuis un lieu, mais depuis un protocole. Elle devient un output, non plus un énonciateur. L’autorité de sa parole ne repose alors plus sur la reconnaissance, mais sur l’apparence. Ce glissement est d’autant plus pernicieux qu’il reste imperceptible à court terme ; le texte “fonctionne”, il se lit, il s’affiche. Mais il ne signe plus rien.
D’autre part, on mine la valeur sémantique du contenu, en saturant les supports de textes à faible densité symbolique ; des contenus qui remplissent sans infléchir, qui énoncent sans déplacer, qui diffusent sans transformer. Or, un texte qui ne reconfigure pas la perception, qui n’ouvre aucun nouvel espace de signification, ne vaut pas plus qu’un bruit d’ambiance que vous entendez dans un café bar. Il n’engage ni affect, ni mémoire, ni désir de relecture. C’est un contenu désincarné, voué à l’oubli.
Les effets sont mesurables. Comme le montre une étude de Skyword (2024), les contenus générés automatiquement sans recontextualisation stratégique présentent un taux d’engagement inférieur de 43 % à ceux produits dans un cadre éditorial exigeant. Ce déficit n’est pas seulement lié à la forme, mais à l’absence de visée. Un texte sans ancrage (sans sujet, sans orientation, sans situation) échoue à établir une relation. Et c’est bien cela que confirme ce rapport : les signaux SEO les plus corrélés à la performance ne sont plus la fréquence, ni même la longueur, mais la pertinence contextuelle, la cohérence narrative et la capacité d’un contenu à exprimer une voix singulière. En d’autres termes, ce n’est plus la génération qui compte, mais l’énonciation située.
Il devient donc urgent de substituer à la logique de remplissage celle d’une énonciation stratégique. Cela implique de repenser l’architecture éditoriale non comme une chaîne de production, mais comme un espace de positionnement symbolique ; un lieu où le langage est un vecteur de singularité, un levier d’identité, un geste éthique. Ce lieu, c’est ce que la philosophie japonaise nomme bashō : un espace d’inscription où le sujet, le contexte et la parole se rejoignent.
La question centrale n’est plus : comment produire plus vite ? Mais : comment produire depuis un lieu habité ?
Une marque qui ne parle plus depuis elle-même devient interchangeable, et donc invisible.
B) De l’échec performatif au contenu sans engagement : un langage sans acte
Pourquoi certains contenus semblent-ils « dire » sans rien accomplir dans l’esprit du lecteur ?
À force de confondre expression et transformation, une part croissante du marketing éditorial produit des discours sans effet. Des phrases s’enchaînent, des valeurs sont nommées, des promesses sont formulées, mais rien ne se passe. Ce qui est censé convaincre glisse, ce qui devrait toucher reste inerte, ce qui affirme échoue à être cru. Le langage, ici, ne produit plus d’acte. Il échoue dans sa performativité, au sens précis qu’en donne J.L. Austin : le discours ne fait plus advenir ce qu’il dit.
On entre alors dans le territoire du misfire, de l’énoncé manqué. John Searle le théorise comme un échec illocutoire : le locuteur prétend faire quelque chose avec ses mots (inspirer, engager, différencier), mais les conditions du langage ne sont pas réunies pour que cela fonctionne. Dans le contexte marketing, cela se traduit par ces slogans flamboyants sans lien réel avec l’expérience, ces mantras de marque que l’on affiche partout sans qu’ils ne trouvent écho dans les usages ou les produits. La promesse devient vide, non par cynisme, mais par désalignement.
L’échec n’est pas seulement conceptuel ou théorique. Il produit des effets visibles, mesurables, mais souvent mal interprétés. Si un énoncé échoue à accomplir ce qu’il prétend, convaincre, mobiliser, faire adhérer, ce n’est pas uniquement qu’il est mal écrit, mais qu’il est discursivement vide. Ainsi, il ne suffit pas que les mots soient justes ou élégants : encore faut-il qu’ils engagent un acte, c’est-à-dire une transformation dans l’esprit de celui qui les reçoit, dans votre esprit et celui de vos visiteurs.
C’est ici que les travaux récents en sciences cognitives et en marketing narratif viennent éclairer, par les données, ce que les philosophes du langage ont longtemps soutenu par l’analyse : le langage n’a d’effet que s’il mobilise une attention orientée, incarnée, susceptible d’ouvrir une brèche dans la routine perceptive du lecteur. C’est précisément ce que montre Zeng (2023) dans une étude sur la performativité des contenus générés par IA : si ces derniers déclenchent un pic d’attention superficielle au moment de la réception (taux d’ouverture, clics initiaux), ils échouent systématiquement à susciter ce que l’auteur nomme une « attention transformatrice » ; celle qui génère un souvenir, une reconfiguration ou un déplacement de position.
Or cette forme d’attention n’est autre que la condition pragmatique de tout acte de langage réussi. Sans elle, l’énoncé reste lettre morte. Il « semble dire », mais ne produit rien. Il simule une parole, sans jamais habiter l’espace du dire. L’étude de Zeng ne vient donc pas valider mécaniquement la théorie d’Austin : elle en révèle la portée pratique. Elle montre que la performativité ne réside pas dans l’élocution, ni même dans la syntaxe, mais dans la capacité d’un énoncé à construire une situation partagée, à faire lieu, à faire événement.
La solution n’est donc pas de produire plus de contenu, ni de le rendre plus “humain” artificiellement, mais de restaurer les conditions de l’acte de langage. Cela suppose une intention lisible, une position assumée, une situation claire. Comme l’a montré Simon Sinek, le “why” ne peut être une formule répétée : il doit être vécu et visible dans chaque énoncé. Dire, c’est aussi faire. Et à défaut d’un tel alignement, les contenus restent des incantations, esthétiques, optimisées, mais symboliquement inertes.
C) Vers une économie symbolique du dire : modérer, situer, formuler
Faut-il produire moins de contenu pour produire plus de sens ?
Le web ne manque pas de mots. Il déborde de textes, d’articles, de newsletters, de micro-phrases sur-optimisées. Et pourtant, jamais le discours n’a semblé aussi peu habité. Le paradoxe est flagrant : à mesure que les contenus prolifèrent, le sens se dilue. On produit pour combler, pour capter, pour remplir des espaces numériques sans fin, mais rarement pour dire juste.
Ce phénomène signe un effondrement de la valeur symbolique du langage. Chaque énoncé répété trop souvent, chaque message recyclé sans nuance, contribue à saturer l’attention sans éveiller la pensée. Georges Bataille rappelait que la valeur, au sens symbolique, naît de la dépense, du non-fonctionnel, du geste gratuit. À l’inverse, un contenu utilitariste, programmé pour capter sans creuser, finit par perdre son intensité. Il devient invisible par excès de visibilité.
C’est ce que montre le cas de Qilibri (avant 2022), plateforme de nutrition personnalisée ayant massivement recours à des contenus générés ou recyclés, sans ligne éditoriale claire ni différenciation narrative. Articles de blog interchangeables, mails aux formulations génériques, descriptions produits sans identité propre : tout concourt à une dilution complète de la voix de marque. Cette stratégie de remplissage éditorial a entraîné une perte de repères pour les utilisateurs, une chute de visibilité SEO, et un taux de fidélisation historiquement bas. Ici, la prolifération de textes n’a produit ni lien, ni confiance, ni engagement durable. Elle a même nui à la clarté de l’offre, en l’ensevelissant sous une couche de bruit.
Dès lors, une écologie narrative devient urgente. Il ne s’agit plus simplement d’optimiser les performances d’un contenu, mais d’en maîtriser la rareté, la clarté, la densité symbolique. Pierre Hadot parlait de la philosophie comme d’un exercice spirituel : une parole qui transforme celui qui la prononce. Pourquoi le marketing ne pourrait-il pas, lui aussi, retrouver une telle exigence ? Une stratégie d’énonciation pensée non comme flux mais comme forme, un espace d’expression choisi, situé, responsable.
Certaines marques, à contre-courant de la logique inflationniste, expérimentent déjà cette rareté signifiante. C’est le cas de Maison Plisson, enseigne alimentaire indépendante qui articule toute sa communication autour d’un minimalisme discursif affirmé. Ici, le contenu n’est jamais bavard ni redondant : chaque mot publié, sur un packaging, un email, un support digital, est choisi avec soin, porteur d’une intention claire, d’une esthétique de la retenue. Le discours devient forme d’attention. Le silence éditorial, loin d’être une absence, fonctionne comme un espace de distinction. Ce que la marque ne dit pas pèse parfois autant que ce qu’elle choisit d’exprimer. Elle n’informe pas seulement : elle affirme, par la forme même de son expression, une posture et une singularité de ton.
Les données confirment cette intuition. L’étude d’Eppler et Mengis (2004), bien qu’un peu ancienne, démontre que la surcharge informationnelle nuit à la clarté cognitive et à la capacité de mémorisation, ce qui suggère que les marques qui privilégient une moindre quantité de contenus, articulés autour d’une forte densité narrative, renforcent l’adhésion et la rétention auprès de leur audience. De plus en plus, on observe que l’accumulation de contenus nuit à la clarté cognitive : face à un flux continu de messages interchangeables, l’attention s’émousse, la mémorisation faiblit, et l’adhésion s’efface. À l’inverse, une parole rare mais dense, construite autour d’une intention forte et d’un récit signifiant, capte mieux l’attention et inscrit durablement la marque dans les esprits.
C’est donc bien une économie du dire qui doit être instaurée. Cela suppose de modérer sans appauvrir, de formuler sans bavarder, de situer sans s’enfermer. Ce n’est pas la quantité de contenus qui construit une marque forte, mais la cohérence, la densité et la justesse de ce qu’elle choisit de dire. Le silence, parfois, vaut plus qu’un énième article. Et dans cet espace resserré, chaque mot pèse, chaque phrase doit mériter d’exister.
II. Le bashō comme lieu du discours : de la structure narrative à l’autorité de la voix
A) Ce que le récit engage : structure, identité, autorité
Comment structurer un récit de marque qui ne soit pas une simple histoire décorative ?
Le storytelling est devenu une injonction. À force d’être omniprésente, la notion s’est vidée de sa substance : raconter est devenu synonyme de séduire, divertir, ou masquer une faiblesse stratégique sous une couche de vernis narratif. Pourtant, derrière cette inflation d’histoires souvent interchangeables, une question demeure : que fait réellement un récit quand il est bien construit ? Et surtout, que perd-on quand il ne fait que survoler les apparences, sans structurer une identité profonde ni affirmer une autorité symbolique ?
Aujourd’hui, une grande partie des contenus de marque produit un storytelling décoratif, sans racine ni structure. Les récits se veulent authentiques, mais peinent à dépasser le stade de l’anecdote. On aligne des événements, on évoque des origines, on injecte un peu d’émotion, mais sans articuler l’ensemble à une vision, à une cohérence narrative. Le récit devient alors une série de signaux faibles sans agencement, et perd sa fonction stratégique première : structurer une identité éditoriale stable, lisible et incarnée.
C’est ici que la fonction du récit dépasse celle de la simple narration décorative pour devenir structurante. Raconter, comme le souligne Paul Ricœur, n’est jamais neutre : cela implique de mettre en intrigue les événements, de les inscrire dans une continuité intelligible, et d’articuler cette continuité à une identité. Le récit ne reflète pas l’essence d’une marque ; il en organise l’existence symbolique. Il donne forme au temps, aux tensions, aux engagements qui la traversent. Une marque qui raconte sans structure, sans orientation temporelle, finit par disperser ses signaux sans jamais composer de voix. Le storytelling devient alors un alignement d’épisodes déconnectés, une collection de moments, et non une trajectoire.
Ce besoin d’organisation narrative rejoint ce que Michel Foucault désigne comme la fonction-auteur : un principe qui assure la cohérence d’un ensemble discursif. Appliquée au marketing, cette idée nous rappelle qu’une marque ne peut déléguer totalement sa narration à ses formats, ses canaux ou ses outils. Elle doit assumer une posture d’auteur : non pas simplement produire du contenu, mais exercer un droit de regard sur la logique, la hiérarchie, la portée symbolique de ce qu’elle énonce. Cette autorité ne se décrète pas, elle se construit, par la clarté de l’intention, la stabilité du point de vue, la reconnaissance d’une voix qui ne varie pas au gré des tendances.
Cette exigence dépasse le simple souci stylistique. Elle engage un positionnement narratif : à partir d’où la marque parle-t-elle ? Quelle voix assume-t-elle ? Quelle autorité lui reconnaît-on ? La réponse à ces questions ne se trouve pas dans les artifices narratifs, mais dans l’architecture même du récit. C’est ici que les enseignements de Tzvetan Todorov restent précieux : toute narration repose sur une structure implicite, un équilibre initial, une perturbation, une résolution. Dans le cadre d’un brand storytelling stratégique, cette structure permet de construire une relation, d’inscrire la marque dans une trajectoire, et d’activer une reconnaissance.
Les conséquences opérationnelles sont claires. Une architecture narrative claire devient un actif stratégique : elle guide les prises de parole, éclaire les choix éditoriaux, harmonise les campagnes. Elle permet à la marque de revenir à ses fondements sans se répéter, de se renouveler sans se contredire. Ce cadre n’est pas un carcan : c’est un espace d’expression cohérent, dans lequel chaque prise de parole vient renforcer l’identité globale.
En ce sens, le récit de marque n’est ni un supplément d’âme, ni une parure décorative. Il est le pilier d’une stratégie éditoriale incarnée, une forme de souveraineté narrative qui oriente la communication bien au-delà du contenu. Refuser de penser cette structuration, c’est s’exposer à une dilution : une marque sans récit ancré devient un flux parmi d’autres, audible peut-être, mais vite oublié.
B) Dire, c’est inscrire : interface, responsabilité et design du sens
Comment faire en sorte que l’interface et le wording expriment réellement la promesse de la marque ?
Un discours n’existe jamais seul. Il passe, toujours, par une forme : page, écran, bouton, typographie, call-to-action. Et pourtant, trop souvent, le wording est traité comme une variable d’optimisation UX, et l’interface comme un simple support visuel. Ce découplage entre le fond et la forme crée un paradoxe courant : une marque peut affirmer des valeurs de proximité tout en imposant une interface froide et distante ; elle peut revendiquer l’authenticité et multiplier les micro-textes artificiels, calibrés pour convertir plutôt que pour signifier.
Le constat stratégique est simple : les interfaces sont saturées de promesses non tenues, de phrases génériques aux allures engageantes mais dont la performativité est nulle. Le design devient alors un écran plutôt qu’un canal, un filtre plutôt qu’un passage. C’est là que s’impose un retournement décisif : penser le design et le wording comme des gestes d’inscription, des actes langagiers engageants, et non comme de simples leviers fonctionnels.
Dans cette perspective, le travail de J.L. Austin retrouve toute sa pertinence. Dire, ce n’est pas seulement formuler : c’est faire. Or, dans l’interface, chaque bouton, chaque intitulé, chaque silence devient un acte. L’UX writing n’est pas un simple art d’écrire court : c’est un art d’inscrire un rapport éthique au monde. Il s’agit d’orchestrer des formes d’énonciation qui soient aussi des formes d’engagement, dans lesquelles l’utilisateur reconnaît non une fonction, mais une posture. Autrement dit, ce que la marque dit par l’interface engage autant que ce qu’elle affirme par ses contenus.
C’est là que Gilbert Simondon et Étienne Souriau peuvent enrichir l’approche. Pour Simondon, tout objet technique, et donc toute interface, suppose une prise de forme liée à une situation. Ce n’est pas seulement un design : c’est une structuration symbolique du rapport au monde. Souriau, quant à lui, nous rappelle que chaque acte est porteur d’un « degré d’existence ». Un micro-message peut donc être insignifiant ou déterminant, selon sa densité ontologique. Ce qui paraît minuscule dans l’interface (l’intonation d’un bouton, la présence ou non d’un interstice) peut faire la différence entre une expérience sincère et une dissonance narrative.
La performance d’une interface ne réside pas dans la quantité de contenus générés, mais dans la cohérence entre le discours, ce qu’elle promet, et la manière dont il est délivré. Trop souvent, un discours plat, générique ou trop abondant dissout l’attention au lieu de la capter. Une formulation claire, située, retenue, produit davantage d’impact. C’est cette économie du dire, structurée et intentionnelle, qui nourrit l’adhésion réelle et durable.
Concrètement, cela suppose de repenser l’UX comme un espace d’énonciation éthique. Chaque geste d’interface devient un lieu d’engagement : non pas au sens moraliste, mais au sens profond d’une posture assumée. Ce que la marque accepte de taire, la manière dont elle formule une promesse, la place qu’elle accorde au vide ou à la densité : tout cela participe d’une responsabilité discursive.
Il ne s’agit donc plus de “rendre l’expérience fluide”, mais de rendre la parole tangible. Et cela passe par une exigence de cohérence absolue : entre les discours de surface, les micro-textes d’usage, les gestes de navigation et le récit global. Une marque qui ne sait pas inscrire sa promesse dans l’interface échoue à faire du digital un lieu symbolique. Elle parle, mais ne s’incarne pas. Elle informe, mais ne signe rien.
C) Le bashō narratif : seul lieu possible d’un langage stratégique
Où réside l’autorité d’un discours de marque quand tout peut être généré ?
À l’ère de la génération de masse, où tout discours peut être produit par des IA en quelques secondes, la question de l’autorité narrative devient centrale. Si tout contenu peut être imité, stylisé, dupliqué, qu’est-ce qui confère encore une légitimité à une parole de marque ? Pourquoi certaines voix demeurent reconnaissables et crédibles, tandis que d’autres, bien qu’optimisées, sombrent dans l’insignifiance ? La réponse ne réside ni dans le style, ni dans la fréquence. Elle réside dans le lieu symbolique depuis lequel on parle.
La tradition japonaise nomme ce lieu le bashō, un terme que le philosophe Nishida Kitarō transforme en catégorie centrale de la pensée. Le bashō, ce n’est pas un point géographique, mais un espace symbolique où s’unissent sujet, monde et discours. Ce lieu n’est pas une simple origine : c’est une condition d’inscription, un cadre de signification, une consistance ontologique. Dans une perspective éditoriale, il désigne ce qui fonde la parole d’une marque, ce qui lui donne sa densité, sa cohérence, sa stabilité dans le temps.
Ne vous y trompez pas : l’erreur majeure que beaucoup commettent aujourd’hui consiste à croire qu’il suffit de multiplier les discours pour exister. Vous pouvez adopter tous les tons à la mode, empiler les éléments de langage, suivre chaque tendance… Si vous ne parlez pas depuis un lieu stable, incarné, aucun de vos messages ne produira de reconnaissance réelle. Car ce qui manque, ce n’est pas le style, c’est le lieu symbolique. Sans espace habité, sans ancrage narratif, votre parole flotte. Et une parole qui flotte, c’est une parole que l’on oublie.
C’est précisément ce qu’a su éviter Le Slip Français, dont la stratégie éditoriale repose sur une stabilité discursive remarquable. Derrière les jeux de mots et la légèreté apparente, chaque publication (du slogan jusqu’à la newsletter) s’inscrit dans un bashō narratif solidement construit : celui de la fabrication locale, d’un ton espiègle mais incarné, d’une culture pop française revisitée. Ce n’est pas seulement une ligne de style, mais un point d’énonciation cohérent. D’où l’effet de familiarité, presque d’intimité, qui naît à chaque prise de parole. Le récit n’est jamais décoratif, il est structurel : c’est la manière dont la marque tient ensemble son histoire, sa promesse et sa voix.
À l’inverse, la trajectoire de Clubhouse, la plateforme sociale audio propulsée par la pandémie, illustre un récit sans lieu. L’enthousiasme initial s’est dilué dans une multitude de narrations sans structure, sans identité stable, sans ancrage clair. Chaque salon était une île, chaque thématique un écho passager. En l’absence de bashō éditorial, l’écosystème s’est dispersé : pas de récit central, pas de point d’unité, pas de voix fondatrice. Le langage y circulait en excès, mais sans qu’aucune position ne tienne. Et lorsque l’effet de nouveauté s’estompa, il ne restait plus rien à quoi se rattacher.
La philosophie vient ici affermir l’intuition stratégique. Ce que Pierre Hadot appelait une “pratique de soi” est transposable à l’énonciation : parler suppose une forme d’attention à ce que l’on incarne. Il ne suffit pas de produire : il faut parler depuis un lieu. Claude Romano, dans sa phénoménologie de l’événement, insiste sur cette nécessité d’un espace de manifestation : il ne peut y avoir de sens sans horizon, de parole sans monde.
Le basho dans la pensée de Nishida Kitarō ne désigne pas un lieu géographique, mais un « lieu ontologique », un espace de co-appartenance entre le sujet, l’acte et le monde. Ce n’est pas la nature du contenu qui garantit la singularité stratégique d’un discours, mais le point d’origine depuis lequel il est formulé. Ce que le basho offre, c’est une profondeur silencieuse : un enracinement de la parole dans une position vécue, assumée, irréductible à une simple fonction rhétorique ou à une optimisation technique. Autrement dit, un contenu devient crédible non parce qu’il est bien rédigé, mais parce qu’il est bien situé.
Opérationnellement, cela se traduit par la construction d’un édifice éditorial cohérent, situé, incarné. Une ligne de discours ne se limite pas à une charte graphique ou à un tone of voice : elle doit refléter un lieu de pensée, une posture dans le monde. Sans cela, la marque devient une coquille. Avec cela, elle devient une présence.
Face à la prolifération des contenus générés, la question n’est plus seulement “que dire ?”, mais “depuis où le dire ?”. Le bashō éditorial devient la nouvelle frontière stratégique : un levier d’ancrage, de distinction, de fidélité. Un lieu d’où parler, et vers lequel revenir.
III. Gouverner la voix à l’ère IA : entre fidélité, cohérence et structure
A) Reprendre sans répéter : la fidélité comme variation signifiante
Dans un environnement saturé de contenus, la répétition devient un piège stratégique. Trop fréquente, elle lasse ; trop mécanique, elle appauvrit. Trop prudente, elle empêche toute évolution. Pourtant, toute ligne éditoriale sérieuse repose sur un principe de continuité : une voix de marque ne peut fluctuer au gré des tendances sans perdre son autorité. Comment, dès lors, rester fidèle à une identité narrative sans sombrer dans l’itération stérile ? Comment renouveler sans trahir ?
Vous l’avez sans doute observé : dans leur quête de cohérence, de nombreuses marques finissent par recycler leurs messages à l’identique. Même slogan, même tournure, même visuel, comme si la répétition formelle suffisait à ancrer une identité. Mais à force de rejouer les mêmes éléments sans réelle variation sémantique, c’est votre discours qui se vide de sa substance. Ce que vous croyez être de la constance devient une simple inertie. Et ce mimétisme, loin de stabiliser votre récit, le fige. Vous ne répétez plus pour habiter une parole, mais pour l’économiser et ce geste, imperceptiblement, désactive votre impact.
Face à cette impasse, la pensée de Søren Kierkegaard offre une ressource précieuse. Dans La Répétition, il distingue deux logiques : celle de la copie (reproduction mécanique d’un modèle) et celle de la reprise, réactivation vivante d’un contenu dans une nouvelle situation. Être fidèle, pour Kierkegaard, ce n’est pas maintenir l’identique, mais rejouer l’essentiel dans un contexte renouvelé. La répétition signifiante est une reprise habitée, un acte de recréation. Ce n’est pas la conservation, mais la fidélité en mouvement.
Paul Ricœur, dans Temps et récit, rejoint cette perspective en montrant que toute identité narrative est dynamique : elle se construit dans le temps, par une dialectique entre mémoire et réinterprétation. La marque, comme le sujet, ne peut exister que dans une tension entre permanence et transformation. La fidélité n’est donc pas un refus du changement, mais une capacité à maintenir un cap tout en reformulant les formes du discours. La constance éditoriale, bien pensée, est une variation maîtrisée.
Cette approche trouve un écho dans les stratégies marketing les plus durables. Comme le note Hans Joas dans The Genesis of Values, la continuité symbolique ne repose pas sur des contenus figés, mais sur des actes signifiants qui réactivent, à chaque itération, le noyau des valeurs. Appliquée au storytelling, cette logique impose une refonte narrative constante : non pour créer du nouveau à tout prix, mais pour dire autrement ce qui compte, dans des formes ajustées au contexte.
Les implications pratiques sont majeures. Une marque ne doit pas craindre la répétition, mais apprendre à la styliser, à la situer, à l’habiter. Il ne s’agit pas de répéter les mots, mais de répéter le sens, d’exprimer les mêmes valeurs à travers des récits évolutifs, des formats renouvelés, des variations de ton. Ce travail exige une conscience aiguë du tempo éditorial, une maîtrise de la mémoire de marque, et une capacité à écouter les signaux faibles du contexte pour ajuster la formulation sans altérer l’orientation.
Refuser cette tension, c’est céder à l’un des deux écueils : l’innovation sans ancrage ou la fidélité sans vie. Dans les deux cas, la parole se vide : soit elle se disperse, soit elle se sclérose. Le seul chemin viable est celui d’une répétition signifiante, d’une fidélité active, capable de transformer sans trahir.
Ainsi, dans un monde dominé par la vitesse et la nouveauté, ce n’est pas l’originalité pure qui garantit la distinction, mais la capacité à maintenir une voix stable tout en modulant son intensité. Rester fidèle, ce n’est pas dire toujours la même chose, mais savoir pourquoi on le dit, et comment l’incarner à chaque fois.
B) L’élégance comme éthique : sincérité dans les détails et dans la forme
Pourquoi l’élégance formelle importe-t-elle autant que le fond dans un monde saturé ?
À mesure que les discours prolifèrent, la visibilité se retourne contre elle-même. La parole n’est plus rare, elle est attendue, prédictible, sur-expliquée. Trop de marques parlent pour dire qu’elles parlent, déployant une énergie considérable pour répéter des vérités qu’elles ne prennent plus la peine d’habiter. Dans ce contexte, l’élégance n’est pas un artifice : elle devient un acte stratégique, une forme d’éthique silencieuse.
C’est dans ce rapport au langage, non comme instrument, mais comme mode de présence, que s’inscrit une nouvelle exigence narrative. Ce que la marque laisse transparaître dans ses interstices – une tournure subtile, une omission significative, une retenue volontaire – pèse souvent plus lourd que ses déclarations. Là où l’UX tend à standardiser, l’esthétique implicite rappelle qu’une parole de marque ne se juge pas à ce qu’elle dit, mais à la manière dont elle le dit, ou choisit de ne pas le dire.
Cette perspective rejoint Junichirō Tanizaki, qui dans Éloge de l’ombre fait l’éloge d’une beauté diffuse, située dans les marges, dans le presque invisible. Pour lui, l’excès de lumière dissout la vérité ; c’est dans la demi-teinte que se loge la sincérité. Transposé au marketing, cela signifie que ce qui fait autorité, ce n’est pas l’expressivité, mais la justesse formelle, la cohérence silencieuse entre la forme et l’intention.
Une cohérence que Confucius nommait cheng, sincérité du geste qui se manifeste par sa justesse, et non par sa revendication. Un langage sincère n’a pas besoin de se dire comme tel : il agit par sa densité, sa retenue, son alignement. Cette éthique du détail constitue une matrice précieuse pour penser la relation entre le fond et la forme dans le design éditorial contemporain.
C’est également le point de contact avec la pensée de Massimiliano Mocchia di Coggiola, pour qui la délicatesse constitue “la forme visible d’une éthique silencieuse”. Dans son œuvre, le langage véritable ne s’impose pas, il se propose. Il suggère, il laisse place, il invite, sans jamais saturer. Ce qu’il appelle “l’authenticité discrète” devient alors un levier stratégique : non pas convaincre par surenchère, mais habiter l’espace du sens par la retenue, la tension, la précision.
Philosophiquement, cette posture rejoint Maurice Merleau-Ponty, pour qui chaque geste, chaque forme, chaque silence est porteur d’une signification pré-réflexive. Une interface, un microtexte, un espace vide : tout participe d’un langage incarné qui structure notre rapport au monde avant même que nous ne le conceptualisions. Ainsi, l’élégance devient l’indice d’une vérité située, non démonstrative mais opérante.
Dans une économie de la saturation, cette forme de sincérité indirecte n’est pas une esthétique de repli. C’est une stratégie de discernement. Savoir où l’on parle, comment l’on parle, et ce que l’on accepte de taire, engage une vision du monde. Cela implique une responsabilité stylistique. Une cohérence narrative. Un respect du lecteur comme sujet, non comme cible.
Il ne s’agit donc plus d’ajouter du contenu à la parole, mais de soustraire ce qui nuit à son intelligibilité. L’élégance, dans cette acception stratégique, est un filtre éthique : elle élimine le superflu, le bavard, le redondant, pour laisser émerger ce qui fait sens. C’est une forme de lucidité éditoriale et c’est ce qui, in fine, distingue une voix durable d’une voix simplement visible.
C) Gouverner l’automatisation : orienter l’IA par le lieu et non par le volume
Comment structurer l’usage d’une IA générative sans diluer la voix stratégique de l’entreprise ?
L’adoption de l’intelligence artificielle générative dans les dispositifs éditoriaux n’est plus une option. Elle s’impose comme un impératif technologique, un levier de productivité, un outil de réponse à la pression temporelle et algorithmique. Mais à mesure que les contenus générés s’accumulent, une tension émerge : celle entre automatisation et cohérence, entre efficacité de production et stabilité narrative. Ce qui est en jeu n’est pas simplement la qualité d’un prompt, mais la survie d’un lieu d’énonciation stratégique.
Le constat est sans appel : de nombreuses marques intègrent des outils IA dans leur chaîne éditoriale sans véritable gouvernance, produisant un corpus de textes parfaitement formatés, mais déchirés de l’intérieur, privés d’unité stylistique, de consistance narrative, de repères symboliques. Ce que la Harvard Business Review (2025) qualifie de « chaos génératif » trouve un écho dans l’analyse de TechRadar (2025) : si la puissance de génération n’est pas arrimée à un cadre, elle devient un facteur de dilution, non d’amplification.
C’est ici que la philosophie du milieu de Watsuji Tetsurō ouvre une piste précieuse. Pour Watsuji, toute subjectivité est co-définie par le fūdo (cet ensemble d’interactions climatologiques, sociales, relationnelles) dans lequel elle prend sens. Parler, pour une organisation, n’est jamais un acte isolé : c’est une manière de s’inscrire dans un monde habité, un milieu de reconnaissance mutuelle. À l’inverse, une IA générative, si elle n’est pas ancrée dans ce fūdo, produit des énoncés sans épaisseur, sans tension ni résonance : un langage abstrait, désitué, indifférent à la vie des formes.
La notion de bashō, chez Nishida Kitarō, vient radicaliser cette intuition. Là où Watsuji pense le langage comme relation située, Nishida pense le lieu comme ce qui rend toute relation possible. Le bashō n’est pas un environnement : c’est une structure ontologique. Il est ce “lieu du rien” d’où peut surgir une parole signifiante, non pas comme contenu, mais comme événement. Tandis que Watsuji nous invite à penser l’éthique du contexte, Nishida nous oblige à penser la condition métaphysique de l’expression. Appliqué au marketing stratégique, cela signifie que l’automatisation ne peut produire de contenu valable sans un lieu d’énonciation déjà constitué, déjà habité par la marque. Générer sans bashō, c’est parler depuis nulle part, et donc ne rien dire, même avec style.
Ce souci du lieu n’est pas propre à la philosophie japonaise. Il trouve un écho inattendu chez Peter Drucker, figure tutélaire du management occidental, qui partage avec Watsuji et Nishida une même méfiance envers l’action désorientée. Là où les premiers parlent de milieu ou de bashō, Drucker pose une exigence de finalité stratégique. Lorsqu’il distingue efficacité (faire les choses correctement) et efficience (faire les bonnes choses), il ne parle pas seulement de performance : il trace une ligne éthique. “There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.” Optimiser un processus, fût-il algorithmique, sans interroger d’abord son orientation, son lieu, revient à perfectionner une erreur. Appliqué à l’IA générative, cela signifie que toute automatisation sans inscription dans un positionnement éditorial habité reste stérile. Ce n’est pas la puissance de l’outil qui fonde sa valeur, mais la clarté du lieu depuis lequel on l’emploie.
Concrètement, cela implique de passer d’une logique d’empilement de contenus à une logique de curation narrative. La gouvernance éditoriale IA repose alors sur deux piliers :
- Un système de prompts structuré (promptboard éditorial), pensé comme une grammaire évolutive qui encode la voix de marque, son ethos, ses limites stylistiques, ses interdits symboliques.
- Un référentiel de tonalité et de cohérence, validé non par les seuls KPIs de performance, mais par une évaluation qualitative de la fidélité narrative : l’IA n’est pas évaluée pour ce qu’elle produit, mais pour ce qu’elle préserve.
Ce renversement de perspective trouve une illustration stratégique dans l’usage maîtrisé qu’a su développer The School of Life. En encadrant l’usage de l’IA par une architecture éditoriale claire, fondée sur un lexique éthique et une charte philosophique interne, la marque maintient une voix stable, même dans des formats courts, générés partiellement, ou diffusés sur des canaux multiples. L’IA n’est pas laissée seule : elle est inscrite dans un bashō éditorial.
À l’opposé, la trajectoire de BuzzFeed (2023–2024) illustre les dangers d’une intégration débridée. Après avoir annoncé massivement la génération automatisée de contenus lifestyle via ChatGPT, sans dispositif de gouvernance symbolique, la plateforme a vu ses indicateurs de rétention s’effondrer, son image éditoriale se fragmenter, et sa crédibilité se heurter à une défiance croissante. L’excès de volume n’a pas renforcé la marque : il l’a désorganisée.
Ce constat est renforcé par l’Oxford Internet Institute (2024), qui insiste sur la nécessité de penser l’IA dans des cadres de responsabilité situés. Ce n’est pas l’outil qui est problématique, mais le désenracinement du langage qu’il produit en l’absence de lieu.
Ainsi, structurer l’usage d’une IA générative n’est pas un enjeu technique. C’est une décision ontologique et stratégique. Il s’agit de faire de chaque contenu non un artefact statistique, mais un acte d’inscription. De transformer l’IA non en producteur autonome, mais en amplificateur maîtrisé d’un langage fondé.
Ce que la gouvernance de l’IA permet alors, ce n’est pas simplement de produire plus. C’est de préserver un monde symbolique, de maintenir un lieu de parole identifiable, de protéger la cohérence interne d’une voix éditoriale. Car au fond, l’enjeu n’est pas de parler plus vite. C’est de continuer à parler depuis quelque part.
Conclusion : Ce n’est pas le contenu qui compte, mais le lieu d’où il parle
À mesure que l’automatisation gagne le langage, le marketing se trouve confronté à une exigence nouvelle : ne plus seulement produire du contenu, mais réapprendre à parler. Parler depuis un lieu, avec une voix, dans une orientation claire. Non pas pour ajouter du bruit à la saturation ambiante, mais pour inscrire une parole responsable, située, habitable.
C’est toute la différence entre un texte qui aligne des phrases et un discours qui engage un monde. Ce que l’intelligence artificielle ne peut simuler, c’est cette tension entre fidélité et variation, entre structure et singularité, entre forme et présence. Là réside le véritable enjeu du marketing contemporain : non plus simplement capter l’attention, mais susciter une reconnaissance, au sens fort que lui donnent Ricœur ou Kierkegaard. Une marque ne peut être crédible que si elle se souvient de ce qu’elle est, de ce qu’elle promet, de ce qu’elle incarne.
En définitive, il ne s’agit pas de choisir entre technologie et humanité, mais de savoir comment habiter technologiquement une parole humaine, c’est-à-dire située, orientée, symboliquement responsable.
Et si c’est cette cohérence que vous cherchez à (re)construire, à crédibiliser, à aligner, entre ce que votre marque dit, fait et inspire : je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour un accompagnement stratégique sur mesure.
FAQ
Une marque perd son bashō narratif lorsqu’elle multiplie les prises de parole sans cohérence interne, sans ancrage clair, ni continuité symbolique. Cela se manifeste par des contenus qui « fonctionnent » techniquement (bon CTR, visibilité) mais échouent à produire de la reconnaissance ou de la fidélité. Le signe le plus visible : plus aucun contenu ne semble « venir de quelque part ».
Le storytelling décoratif amuse, émeut parfois, mais ne construit rien. Le récit stratégique, lui, organise le sens, articule le temps et structure une identité. Il permet de parler depuis une position et non simplement à propos de soi. La différence réside dans la fonction structurante du récit : une marque bien racontée est une marque mieux perçue.
Oui, à condition d’être strictement orientée par une voix, une intention, un lieu d’énonciation. L’IA peut amplifier une parole cohérente, mais ne peut ni la fonder, ni la stabiliser seule. Sans direction éditoriale claire, elle produit du volume, non du sens.
Parce que dans un monde saturé de messages explicites, la discrétion devient une forme d’autorité. L’élégance narrative manifeste une posture : celle d’une marque qui n’a pas besoin d’en faire trop pour être crue. Le détail devient alors un espace d’expression de la sincérité, donc de la crédibilité.
La clé est de penser la fidélité non comme répétition mécanique, mais comme variation signifiante. Une ligne éditoriale forte n’exclut ni la nuance, ni l’évolution : elle les oriente. C’est en maîtrisant les transformations, et non en les figeant, que la marque maintient sa cohérence sans sombrer dans la redondance.