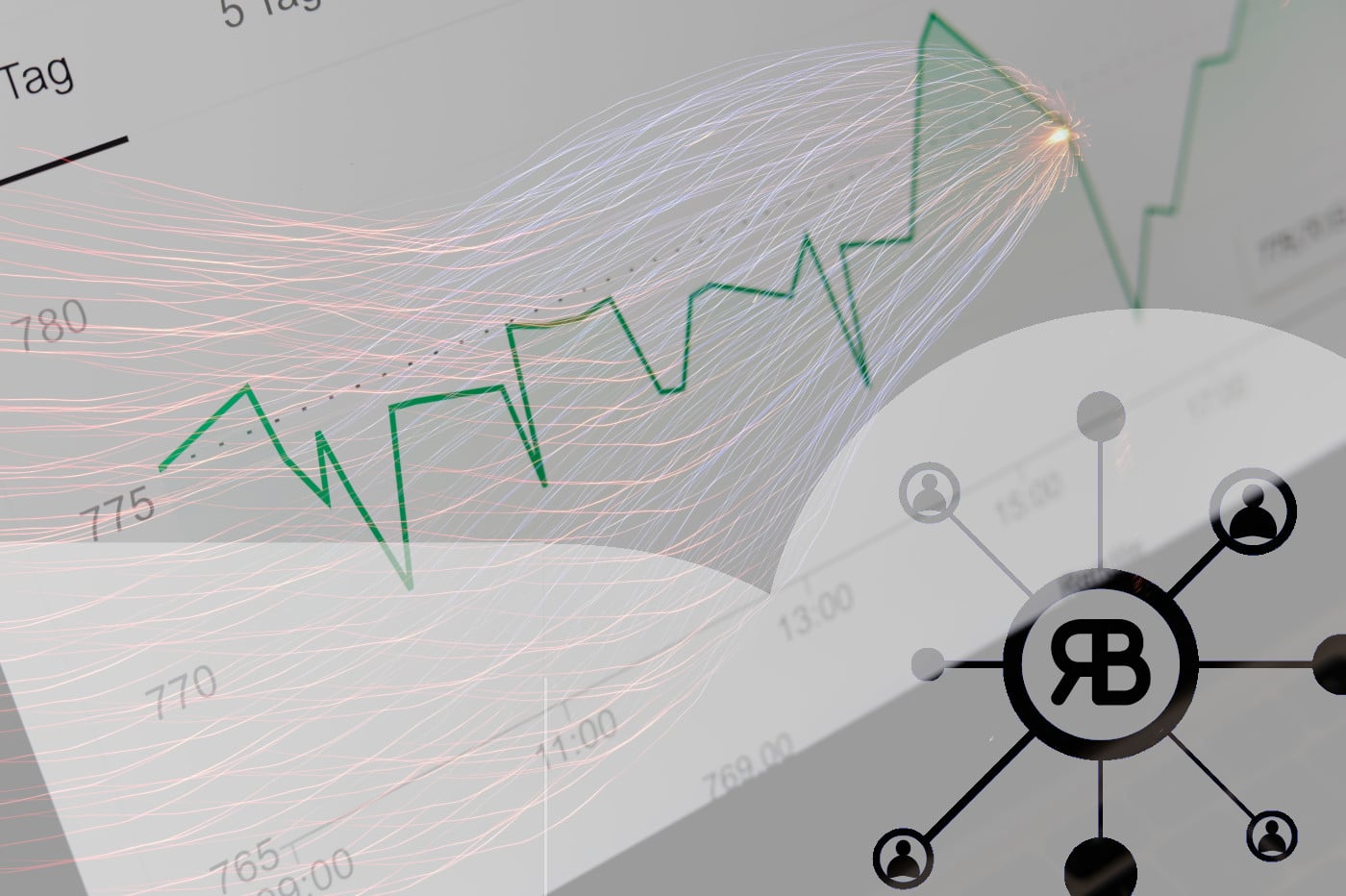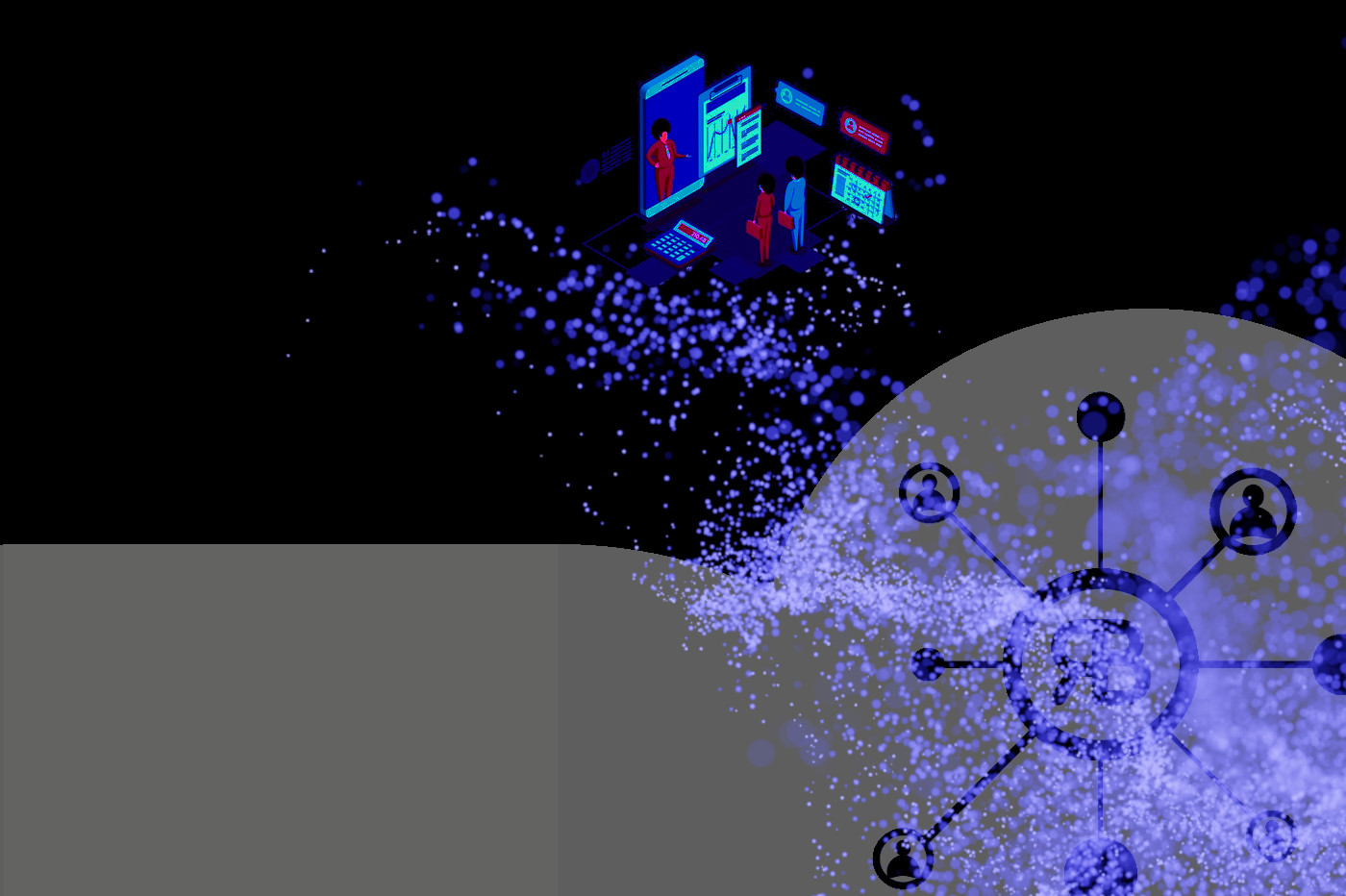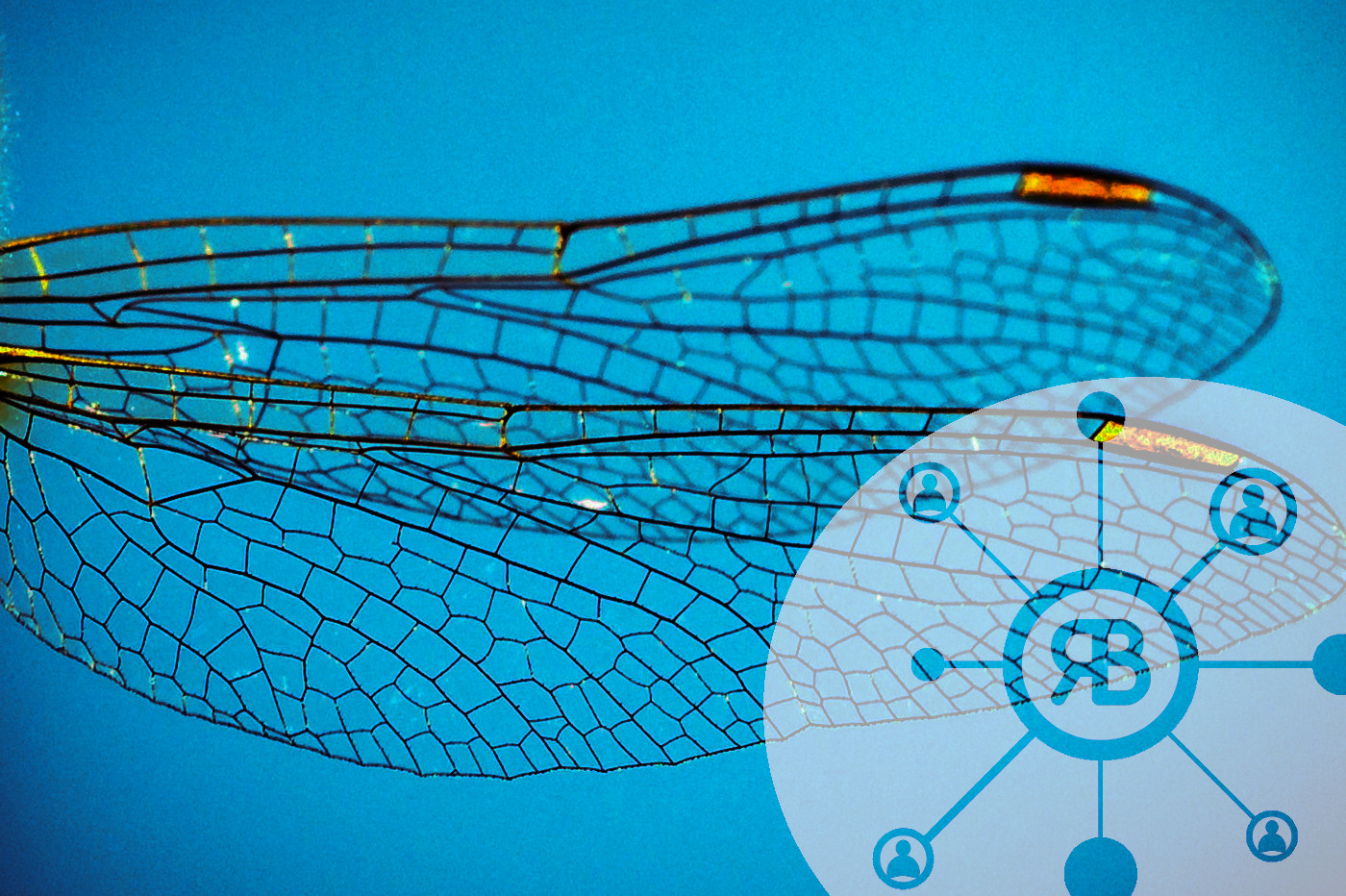Il fut un temps où l’on pensait que le récit pouvait tout réparer. Qu’un bon storytelling suffisait à réenchanter une marque, à masquer ses contradictions, à redonner du sens à l’acte d’achat. On peignait des intentions, on rhabillait des produits, on convoquait l’émotion à défaut de vérité. Mais dans un monde saturé de contenus et désorienté par la multiplication des signaux contradictoires, le récit n’est plus un supplément d’âme. Il est devenu une épreuve de légitimité. Ce n’est plus la narration qui différencie, c’est le lieu d’où elle parle.
Car le contenu ne parle pas : il engage. Il dit ce que l’organisation tolère, ce qu’elle rend visible, ce qu’elle juge digne d’être montré, et donc ce qu’elle est. Raconter ne consiste plus à aligner des éléments de langage ; c’est tenir une voix. Dans les interstices du design, dans les micro-interactions, dans la structure même de l’architecture narrative, se loge désormais la vérité (ou le mensonge) de la promesse. Or, bien souvent, le récit digital est traité comme un habillage : une surcouche commode, esthétisante, parfois inspirée, mais rarement située. Il manque d’ancrage. Il flotte.
Ce texte part d’une exigence simple : refuser que la narration soit réduite à un artifice. Il propose une autre lecture du storytelling digital ; non pas comme vecteur de fluidité, mais comme mise en tension éthique, esthétique et stratégique. À rebours des discours sur l’“expérience” entendue comme fluidité ou séduction, il défend une conception du design narratif comme scène du sens. Ce que nous appelons ici basho, emprunté à la pensée de Nishida, n’est pas un espace de communication. C’est un lieu intérieur, une orientation symbolique depuis laquelle une parole devient possible et crédible.
La question centrale est donc celle-ci : comment concevoir une narration digitale qui ne se contente pas d’être fluide ou performante, mais qui engage une voix située, fidèle à une orientation éthique et cohérente avec l’identité réelle de la marque ?
Pour y répondre, l’article examine trois tensions fondamentales : il s’attache d’abord à comprendre la nature du récit, non comme un levier marketing parmi d’autres, mais comme une forme d’engagement existentiel. Il aborde ensuite le design narratif en tant que scène de performativité, et non comme une simple surface d’expérience. Enfin, il interroge les conditions d’une gouvernance narrative réellement habitée, dans laquelle l’UX, le contenu, le SEO et l’IA ne trahissent pas la promesse initiale, mais la reformulent avec fidélité.
Ce n’est donc pas un manuel de storytelling, mais une invitation à repenser le marketing narratif à partir d’une exigence plus haute : celle d’une parole qui ne cherche pas à séduire, mais à tenir. Une parole qui fait signe, parce qu’elle vient d’un lieu.
I. Le récit n’est pas un levier : penser le contenu comme orientation existentielle
1.1. Le récit comme promesse engagée, non comme décor performatif
Pourquoi mon storytelling ne génère-t-il plus de confiance, malgré un bon design et une belle histoire ? La question hante aujourd’hui bien des stratégies de contenu. Les dispositifs sont là : visuel soigné, narration émotionnelle, structure engageante. Pourtant, quelque chose ne prend pas. L’histoire semble juste, mais elle ne sonne pas vrai. C’est que le récit, aujourd’hui, ne se joue plus dans la surface mais dans l’alignement.
Un récit digital ne peut plus être un décor performatif, un simple vecteur destiné à accompagner l’utilisateur. Il devient l’expression d’une intention. Et cette intention, pour convaincre, doit être tenue. C’est ici que commence ce qu’on appelle un storytelling éthique : non pas un habillage discursif mais un engagement symbolique, où chaque contenu est porteur d’un positionnement moral, pas seulement stratégique.
La philosophie ne dit pas autre chose. Paul Ricœur, dans Temps et récit, rappelle que la narration n’est jamais neutre : elle articule action, mémoire et orientation. À travers le récit, un sujet ne se contente pas de relater ce qui fut ; il se situe, il construit une compréhension de soi dans le temps. Transposé au champ de la stratégie, ce principe oblige toute organisation à considérer que ce qu’elle raconte d’elle-même engage bien plus que son image : cela structure la manière dont elle se perçoit, se projette et agit. Le récit devient alors une médiation entre son passé, son présent vécu, et son orientation future, une ligne de cohérence, non un artifice de contenu.
Cette articulation entre récit et engagement moral trouve une résonance profonde chez Abraham Heschel, pour qui le langage n’est pas un simple instrument fonctionnel, mais un acte spirituel de présence au monde. Dire, c’est déjà juger digne ce qui est dit. C’est, dans chaque mot, témoigner d’un regard sur le réel et affirmer une responsabilité. Dans cette perspective, le récit digital (fut-il court, visuel, diffusé en scroll) ne peut être dissocié de la posture éthique de celui qui le produit. Il ne transmet pas seulement une information : il révèle une manière d’habiter le monde.
Enfin, Okakura Kakuzō, dans Le Livre du thé, nous rappelle que la vérité d’un univers narratif ne se juge pas à l’ampleur de son discours mais à la sincérité de ses détails. L’élégance n’est jamais démonstrative ; elle repose sur une justesse invisible, presque silencieuse, où chaque élément (une pause, une texture, une teinte) reflète une cohérence intérieure. De la même manière, un bon récit de marque n’a pas besoin de forcer la preuve : il résonne parce qu’il vient d’un lieu juste, d’un alignement profond entre l’intention, le ton et l’expérience proposée.
Ces voix dessinent, ensemble, une exigence : celle d’un récit incarné, enraciné dans une posture réelle et constante. Toute narration qui ne reflète pas une brand intention cohérente, c’est-à-dire une orientation morale tenue dans la durée, finit par se heurter à une forme de scepticisme. La fluidité peut séduire un instant ; seule la fidélité symbolique crée la confiance durable. Car dans un monde saturé de récits, ce n’est plus l’histoire qui différencie, mais ce qu’elle révèle (ou dissimule) du lieu d’où elle parle.
Ainsi, penser le marketing narratif aujourd’hui, c’est accepter que le contenu ne soit plus un outil parmi d’autres, mais le révélateur d’une orientation. Un test de vérité. Là où le récit se contente de raconter sans assumer ce qu’il engage, la défiance s’installe. Là où il procède d’un lieu vrai, il devient une force stratégique.
1.2. Dire, c’est engager : ethos, performativité et responsabilité du récit
Pourquoi mon interface utilisateur communique-t-elle une expérience fluide mais ne génère pas d’engagement sincère ?
La question paraît anodine. Pourtant, elle trahit une confusion tenace : celle de croire que le design UX se limite à orchestrer un parcours fonctionnel, quand il est en réalité une scène discursive. Ce que l’on montre, ce que l’on rend possible, ce que l’on laisse dans l’ombre, tout cela forme un discours, implicite mais décisif. L’interface, dans ses micro-interactions, ne dit pas seulement comment accéder à une fonctionnalité. Elle énonce ce que la marque considère comme important, légitime, digne d’être ressenti. Et ce dire engage.
Dans How to Do Things with Words, J. L. Austin distinguait trois niveaux d’actes de parole : le locutoire (ce qui est dit), l’illocutoire (l’intention d’agir en disant), et le perlocutoire (l’effet produit sur l’interlocuteur). Appliquée à l’UX, cette distinction bouleverse notre compréhension du design narratif : chaque message d’erreur, chaque libellé de bouton, chaque animation de chargement devient un énoncé illocutoire. Ce n’est pas “juste un détail”, c’est une prise de parole ; une promesse implicite sur la relation que la marque entend entretenir avec celui qui l’écoute. Et comme tout énoncé performatif, il peut réussir ou échouer, selon qu’il est prononcé avec autorité, cohérence, et reconnaissance.
Cette dimension éthique du dire trouve une profondeur radicale chez Søren Kierkegaard. Dans Crainte et Tremblement, il écrit que l’acte véritable engage sans justification extérieure. Il est saut, non calcul. De la même manière, un design de communication réellement éthique ne peut se contenter d’un alignement visuel ou d’un benchmark. Il repose sur une voix assumée, capable de poser un geste symbolique, parfois discret, mais irréductiblement sincère.
C’est ce que développe aussi Kuki Shūzō dans sa réflexion sur le concept d’iki, cette forme d’élégance japonaise qui conjugue style, retenue et vérité morale. L’iki n’est ni pure esthétisation ni effet de posture : il incarne une attitude face au monde, une manière d’être juste dans tous les sens du terme. Il désigne ce moment rare où le goût, la sobriété, l’authenticité et la finesse s’accordent sans ostentation. Dans l’univers du design narratif, l’iki devient alors une boussole précieuse : il nous rappelle que le détail est une éthique. Une interface peut être visuellement réussie, techniquement fluide, mais si elle déborde de surenchère, de ton artificiel ou de fausse proximité, elle rate l’essentiel. À l’inverse, une navigation épurée, une tonalité sobre, un wording retenu mais juste peuvent faire résonner une promesse silencieuse mais crédible.
L’iki, c’est la distinction sans arrogance, la sincérité sans démonstration. C’est ce que traduit, dans l’UX, un label discret mais porteur de sens, un bouton d’action qui ne surjoue pas l’engagement, une animation qui ne cherche pas à séduire mais à accompagner. Le souci du détail n’est pas ici un luxe : c’est un engagement dans la forme, un ethos discursif qui donne à voir une marque non pas performative au sens du spectaculaire, mais au sens fort du terme, une marque dont chaque micro-interaction engage une orientation morale cohérente avec son identité. L’iki, dans cette perspective, n’est pas un supplément esthétique ; il est le sceau silencieux d’une intention fidèle, perceptible seulement par ceux qui savent lire dans la forme ce qui ne peut être dit autrement.
Dès lors, le design narratif ne peut plus être pensé comme une surface. Il devient un langage. Et comme tout langage, il comporte une dimension performative : il agit sur l’autre, non par sa beauté, mais par la fidélité qu’il révèle entre le visible et l’intention. C’est là toute la difficulté, mais aussi toute la noblesse, du marketing narratif : faire en sorte que chaque signe, chaque mot, chaque silence numérique, participe à une parole habitée.
Mais la performativité, si elle engage, ne suffit pas : encore faut-il que cette parole ait un lieu d’origine. Car toute voix, pour être entendue comme sincère, doit parler depuis quelque part, non depuis une fonction, mais depuis un ancrage. C’est à cette condition seulement que le discours cesse d’être posture pour devenir présence.
1.3 – Le basho narratif : le lieu d’où une voix peut parler
Pourquoi ma marque semble-t-elle manquer de cohérence malgré des contenus bien produits ?
Parce qu’une voix, aussi soignée soit-elle, ne peut convaincre si elle ne parle de nulle part. Ce n’est pas le ton qui crée la confiance, mais l’ancrage, ce basho intérieur, d’où la parole puise sa légitimité symbolique.
La cohérence narrative n’est pas affaire de syntaxe homogène ou de design unifié. Elle repose sur la capacité d’une organisation à habiter une orientation ; non comme slogan, mais comme lieu. Kitarō Nishida nomme basho ce lieu logique, irréductible à une fonction ou à un espace. Le basho n’est pas l’interface, ni le canal, ni même la ligne éditoriale. C’est le sol éthique et symbolique d’où la voix s’élève. Une marque qui parle sans basho multiplie les contenus sans qu’aucun ne tienne : elle sonne juste, mais elle ne résonne pas.
Cette exigence d’un lieu de parole, Pierre Hadot la formule autrement : pour lui, toute philosophie véritable est un exercice spirituel, c’est-à-dire l’expression incarnée d’une pensée vécue. Il ne suffit pas de dire, il faut que la voix vienne de quelque part. Dans l’espace digital, cela implique une cohérence qui dépasse la tonalité ou le design : ce qui est en jeu, c’est une fidélité intérieure, une tension entre ce qui est dit et ce qui est vécu.
Shūichi Katō, dans son étude sur l’esthétique japonaise, évoque la cohérence invisible qui lie les formes à une intention fondatrice. Il ne s’agit pas d’un branding explicite mais d’une résonance discrète, qui permet de reconnaître une marque, non à ses claims, mais à sa posture. Ce lien souterrain entre forme, rythme, ton et identité constitue la véritable structure du récit. Le basho narratif est ainsi ce lieu d’où une voix peut parler sans tricher, même dans les silences, même dans les interstices.
Certaines marques, comme The Ordinary, incarnent parfaitement cette logique. Leur discours n’est pas enjôleur, leur design n’est pas spectaculaire, mais tout, du nom des produits jusqu’au style de leurs fiches, exprime une même rigueur, une même sobriété. Ce n’est pas un récit plaqué, mais une forme cohérente d’austérité volontaire, enracinée dans un lieu de pensée : celui d’une science accessible, dépouillée de séduction.
À l’inverse, WeWork, dans ses années de croissance effervescente, a tenté de narrer une communauté, une spiritualité, une “mission” fondée sur le bien-être. Mais cette voix flottait. Elle s’est révélée sans lieu, sans cohérence avec la structure financière, les pratiques de gouvernance, les choix managériaux. Ce qui aurait pu être un récit s’est dissous dans le storytelling de façade. Le basho était absent, ou, pire, fictif.
Le marketing narratif exige plus qu’un message. Il suppose un ancrage symbolique, une articulation entre l’intention fondatrice et la forme prise par la parole. Sans cela, le récit est une coquille. Mais lorsqu’une voix émerge d’un basho habité, elle ne cherche pas à convaincre : elle s’impose par fidélité.
Mais encore faut-il que cette fidélité puisse s’inscrire dans les formes mêmes de l’expérience utilisateur. Car si la voix est située, encore faut-il qu’elle puisse être entendue. Ce n’est donc plus seulement la question du lieu qui se pose, mais celle du rythme et de la forme : le design narratif, dans sa matérialité, dans ses transitions, dans son silence même, parle-t-il depuis ce lieu ?
En d’autres termes : pourquoi tant d’interfaces pourtant soignées, fluides, bien conçues, peinent-elles à faire passer un sens durable ? Est-ce parce qu’à force de vouloir séduire, elles cessent de dire ?
II. Le design narratif comme scène du sens (et non comme surface d’expérience)
2.1 – L’architecture UX n’est pas neutre : elle impose un rythme narratif
Pourquoi mes utilisateurs “comprennent” moins mon message alors même que leur navigation est plus fluide ?
La question, aujourd’hui banale dans nombre de revues de performance UX, révèle une illusion tenace : celle de croire que la clarté du parcours garantit la clarté du sens. On réduit alors l’architecture narrative à un enchaînement sans heurts, comme si la vérité d’un propos naissait de la fluidité de son exécution. C’est oublier que tout design, même minimal, est déjà un langage. Et que toute interface est, en réalité, une scène.
Ce que l’on appelle UX storytelling ne commence pas au moment où l’on ajoute une couche narrative sur un service. Il commence dans la structure même : dans l’ordre d’apparition des éléments, dans les silences entre deux blocs, dans les transitions qui rythment l’interaction. Une interface n’est pas un décor fonctionnel ; c’est une architecture de signifiants. Elle hiérarchise, intrigue et oriente. En cela, elle raconte. Pas par les mots seuls, mais par la forme. C’est ce que Claude Romano appelle dans L’événement et le monde la capacité d’une forme à faire surgir du sens non comme information, mais comme saisie. Un design qui parle est un design qui met en tension.
De manière plus subtile, Itō Jinsai, dans sa réflexion sur la langue classique, rappelle que tout rythme est porteur d’une orientation morale. Ce n’est pas seulement ce que l’on dit, mais la cadence dans laquelle on le dit qui donne forme à la vérité. Une interface qui bouscule, qui précipite, qui surstimule, empêche la parole de s’incarner. À l’inverse, une navigation qui respire, qui laisse des temps faibles, qui ménage des silences, ouvre l’espace symbolique d’une compréhension située.
Cette idée trouve un écho inattendu chez Ernst Jünger. Dans Le Travailleur, il suggère que seule la forme peut résister au flux : non pour s’y opposer frontalement, mais pour y créer une tenue. Ce que le design narratif permet, alors, ce n’est pas de contenir l’expérience, c’est de lui donner une tension intérieure. Le design n’est pas neutre. Il est résistance symbolique à la dissolution du sens dans la performance.
On comprend ici que l’UX narrative ne vise pas à séduire par la fluidité, mais à structurer un engagement. Elle est une grammaire de la cohérence. Là où les gestes du design ne s’alignent pas sur une intention, l’expérience devient dissonante. L’utilisateur passe, certes ; mais il ne retient rien. Il ne s’attache pas. Parce qu’il n’a pas été convoqué à entrer dans un récit.
Prenons deux cas concrets. Le site de la marque Aesop, par exemple, structure son interface comme une liturgie esthétique. Le rythme lent des animations, la hiérarchie visuelle dépouillée, le silence typographique participent d’une invitation à la contemplation. Ce n’est pas un parcours, c’est un espace symbolique : chaque geste prolonge une philosophie du soin, du détail, de l’élégance retenue. L’UX devient ici récit habité, architecture de sens.
À l’inverse, les interfaces de CDiscount, malgré leur richesse fonctionnelle, dispersent le sens. L’accumulation d’éléments, la hiérarchie confuse, les interruptions par des auto-play et des recommandations constantes créent un environnement où le message de marque (si tant est qu’il en reste un) se dilue dans le bruit. La navigation est performante, mais désorientante. On passe, mais on ne perçoit rien. L’expérience est fluide, mais elle n’est pas narrative. Le design raconte — mais il ne raconte rien.
C’est là une des leçons fondamentales de cette section : dans un monde digital saturé d’objets interactifs, la forme devient le message. Et le rôle du design n’est plus d’optimiser le parcours, mais de ménager une scène dans laquelle une parole habitée puisse émerger.
2.2 – IA et récits automatiques : la tentation de la duplicité
Puis-je automatiser mes contenus narratifs sans perdre l’âme de ma marque ?
La question, posée avec pragmatisme, soulève un dilemme éthique et stratégique. L’automatisation des contenus promet des récits scalables, personnalisés, contextualisés. Mais à mesure que les interfaces génératives se perfectionnent, un danger sourd émerge : celui d’un langage sans lieu, d’une parole sans sujet, d’un récit sans promesse.
Car l’intelligence artificielle n’est pas un outil neutre. Elle produit du discours, et tout discours engage, voire devient performatif. Le risque n’est pas dans la production elle-même, mais dans le glissement progressif vers une narration vidée de son éthique. Le prompt devient formule, le contenu devient artefact. Et la voix, qui portait la fidélité d’un engagement, se dissout dans une logique d’efficacité algorithmique.
Ce que Hans Jonas désignait comme principe responsabilité trouve ici une actualité brûlante. Toute technologie narrative, surtout lorsqu’elle est générative, impose une obligation d’anticipation. Que produit-on, au juste, quand on délègue à la machine le soin de parler ? Que signifie la fidélité, quand la voix peut être multipliée, ajustée, fragmentée à l’infini ? Si l’on n’en fixe pas les conditions morales, l’IA devient non pas une extension du récit, mais un point de rupture dans la chaîne symbolique.
Shoeki Andō, dans sa critique du langage vide, alertait déjà sur cette tentation : celle d’un discours qui s’accumule sans référent, d’un usage du langage comme surface performative déconnectée de tout fondement éthique. L’IA, mal encadrée, réalise cette prophétie. Elle simule la voix sans en porter le poids, en mimant l’orientation sans en assumer l’origine. Ainsi, elle permet tout, sauf la tenue.
Or, selon J. L. Austin, tout énoncé n’est pas nécessairement un acte réussi. Il peut échouer, par absence de contexte, de reconnaissance ou de légitimité. On parle alors de misfire. Appliqué au champ narratif, cela signifie qu’un contenu IA peut sembler pertinent, voire performant, tout en constituant une trahison implicite de l’identité de la marque. Le récit devient performatif, certes, mais au sens faible : il agit sans incarner, il produit sans dire.
C’est ce que montre, dans toute sa clarté, l’exemple du Buzzfeed AI Content en 2023. En lançant massivement des contenus générés par IA (quizz, listes, horoscopes) sans ligne éditoriale claire ni voix cohérente, la marque a sacrifié toute narration située au profit du clic. Résultat : perte de légitimité, rejet des lecteurs, confusion généralisée. Le récit était là, techniquement parlant, mais il ne disait plus rien de vrai.
À l’inverse, certaines marques expérimentent une génération narrative responsable. Shiseido, par exemple, a intégré l’IA dans ses interfaces tout en conservant une voix habitée. Les prompts sont encadrés, la structure éditoriale reste fidèle à l’univers sensoriel et éthique de la marque. Même les fiches produits IA prolongent le ton de soin, de discrétion, d’élégance implicite. La machine ne remplace pas : elle prolonge, dans un cadre fixé.
Ainsi, automatiser ne signifie pas renoncer. Mais cela implique un travail préalable sur ce que l’on engage dans chaque parole produite, même par une machine. Cela suppose d’encadrer les prompts non seulement du point de vue fonctionnel, mais éthique. Cela exige, en somme, une voice integrity in AI : une continuité de ton, une cohérence de posture, une fidélité à l’intention fondatrice.
Reste alors une autre question, plus insidieuse : si l’IA peut écrire notre récit, qui en est encore l’auteur ? Et si le classement de nos contenus dépend d’un algorithme, comment garantir que cette voix reste située ?
2.3 – Le SEO narratif peut-il rester un récit habité ?
Comment concilier référencement naturel et profondeur narrative ?
La question semble technique, mais elle est en réalité existentielle. Car structurer un contenu pour le faire remonter dans les classements ne signifie pas seulement le rendre visible : cela implique de choisir ce qui mérite d’être mis en lumière, de hiérarchiser symboliquement le discours. Le SEO, dans sa version la plus brute, classe, mais ne pense pas. Et c’est là que se joue le vrai dilemme : faut-il trahir le récit pour plaire à l’algorithme, ou peut-on faire de la structure elle-même un témoignage de fidélité ?
La plupart des entreprises abordent le référencement comme une mécanique : balises, maillage, densité, rythme. Mais cette logique oublie que la hiérarchisation n’est jamais neutre. Un H1, un snippet, une métadescription ne sont pas de simples artefacts techniques ; ce sont des promesses. Ils disent ce que la marque considère comme essentiel, et donc ce qu’elle est. À cet égard, le SEO n’est pas un outil de performance : c’est une épreuve de vérité.
Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, s’inquiétait déjà de l’effet dissolvant des systèmes qui classent sans profondeur : la tentation de tout réduire à l’accessible, au mesurable, au visible. Cette critique trouve aujourd’hui un écho inattendu dans les interfaces narratives des marques : à force d’optimiser pour le clic, on finit par ne plus rien dire. Ce que le classement rend visible, c’est souvent ce qui pèse le moins.
Mais il est possible de concevoir un SEO habité, c’est-à-dire un référencement qui prolonge l’intention fondatrice plutôt que de la recouvrir. Cela suppose de penser les balises comme des gestes narratifs. Yamazaki Ansai, dans sa réflexion sur la fidélité rituelle, rappelait que toute forme héritée peut être réinvestie, à condition de rester fidèle à l’esprit qu’elle véhicule. Il ne s’agit donc pas de refuser la structure, mais de l’habiter avec justesse. Une arborescence peut être signifiante. Un maillage peut créer une mise en intrigue. Une balise peut porter une voix.
Certaines maisons l’ont bien compris. Le Bon Marché, par exemple, structure ses fiches produits avec une économie de moyens qui traduit une fidélité à l’élégance discrète : pas d’accumulation, mais des rubriques éditorialisées, des introductions sobres, une place laissée à l’image mais toujours encadrée par un récit de style. Même dans ses contenus SEO, la marque refuse la dilution. Le référencement y devient prolongement du discours, non greffe artificielle. Ici, les métadonnées ne sont pas neutres : elles prolongent une voix, elles expriment une posture.
À l’inverse, Temu, plateforme ultra-compétitive, applique une stratégie SEO fondée sur la prolifération. Fiches sur-optimisées, redondances sémantiques, mots-clés massifs : tout est pensé pour remonter, rien pour signifier. Le récit y est absent, ou du moins interchangeable. On n’achète pas un produit, on clique sur une occurrence. Le classement fonctionne, mais il ne raconte rien. On accède, mais on n’entre pas. Le SEO y est un langage vide, un système technique sans orientation, où la structure devient dissociée de toute mémoire ou cohérence. C’est ce que Karl Jaspers aurait qualifié de classement sans lumière. C’est ainsi une hiérarchie qui, faute de verticalité existentielle, ne révèle plus rien de l’essentiel, mais se contente de trier.
Ce que révèle cette tension, c’est qu’un SEO éthique n’est pas une contradiction : c’est une promesse tenue dans la structure. Il ne s’agit pas de sacrifier la performance, mais de refuser que l’algorithme devienne maître du récit. À l’heure des prompts IA, des plans automatiques, des FAQ générées à la chaîne, la question n’est pas de faire plus, mais de dire mieux, depuis un lieu. Même une balise peut porter un souffle, si elle est habitée.
III. Habiter la durée narrative : gouvernance du sens et fidélité de la forme
3.1 – Répéter sans figer : la fidélité n’est pas la répétition
Comment rester fidèle à mon récit de marque sans devenir répétitif ou désuet ?
Cette question traverse aujourd’hui toutes les stratégies de contenu. Car dans un univers saturé de récits, répéter sans lasser devient un art subtil. Trop d’organisations confondent cohérence et itération mécanique : elles reproduisent des messages, répliquent des visuels, dupliquent des formulations. Mais la fidélité n’est pas la copie. Elle est reprise. Et toute reprise, pour demeurer signifiante, doit se réinventer.
C’est ce que Søren Kierkegaard nomme la répétition signifiante (La Reprise) : une recréation intérieure, un geste qui ne nie pas le passé mais le ravive, en pleine conscience. La narration stratégique s’inscrit dans cette logique existentielle : elle rejoue la même intention, non sous la forme d’un calque, mais comme un acte vivant, ajusté à chaque scène d’énonciation. Être fidèle, ce n’est pas figer, c’est rejouer en vérité.
Cette dynamique d’actualisation trouve un écho conceptuel chez Hans Joas, dans The Genesis of Values. Il montre que les valeurs ne procèdent pas d’un système clos, mais émergent de l’expérience vécue, de l’agir. Ainsi, le récit n’est jamais un canevas préétabli : il est structure du sens en devenir, à gouverner sans le rigidifier. Répéter un message, dès lors, ne consiste pas à l’amplifier mécaniquement, mais à le faire résonner différemment selon les formats, les temporalités, les usages. Une culture narrative vivante ne repose pas sur la constance des formes, mais sur la cohérence des intentions.
Ce lien entre fidélité et souplesse est également au cœur de la pensée zen de Takuan Sōhō. Dans L’esprit indompté, il décrit la maîtrise non comme répétition rigide, mais comme relâchement créateur. Le geste (ici du sabre, mais l’analogie vaut pour le récit) n’a de sens que s’il est porté par l’esprit. Répéter sans conscience, c’est devenir mécanique ; répéter avec justesse, c’est renouveler sans trahir. Ainsi, il en va de même pour le contenu de marque. Sans une stratégie de contenu fondée sur la reprise signifiante, toute fidélité devient prison. La répétition ne vaut que si elle est habitée, et rejouée à chaque fois comme la première.
Les marques les plus fortes ne sont pas celles qui répètent à l’identique. Ce sont celles qui parviennent à maintenir, dans la diversité de leurs formats, une récurrence signifiante. Elles incarnent un storytelling éthique : non pas un slogan, mais une forme toujours recommencée, fidèle, mais jamais figée.
3.2 – La sincérité se niche dans les détails : micro-interactions et vérité narrative
Pourquoi certains détails dissonent-ils dans mon expérience utilisateur, malgré une belle charte ?
La question paraît mineure. Elle est pourtant centrale. Car dans l’économie contemporaine de l’attention, ce ne sont pas les grandes narrations qui forgent la confiance, mais les micro-interactions signifiantes. Chaque bouton, chaque animation, chaque page d’erreur silencieuse ou alertes discrètes porte un ethos UX, c’est-à-dire un engagement symbolique sur la manière d’être présent.
Simone Weil insistait sur ce point : l’éthique ne se proclame pas. Elle se montre dans l’attention portée aux détails. Ce que le design exprime sans le dire forme le vrai discours. Une animation qui ralentit au bon moment, un texte de confirmation non robotique, une icône qui n’humilie pas l’erreur mais l’accompagne : autant de silent touchpoints qui parlent juste.
C’est ce que Jun’ichirō Tanizaki appelle dans Éloge de l’ombre l’esthétique du discret. C’est une beauté qui ne s’impose pas, mais laisse transparaître, à travers le jeu des ombres, une cohérence silencieuse. Ce n’est pas la lumière qui fait sens. Cependant, celui-ci se retrouve dans l’agencement du visible et du retenu, la capacité à suggérer plutôt qu’à exhiber. De la même manière, une expérience utilisateur narrative réussie ne repose pas sur la performance graphique, mais sur la tenue éthique du moindre détail : un libellé juste, une transition sobre, une animation qui accompagne sans chercher à séduire. Ce sont ces choix invisibles qui révèlent une intention habitée, une orientation fidèle.
On comprend alors que le design, loin d’être un simple décor, devient un geste moral de mise en forme du monde. Et dans ce geste, parfois, une beauté singulière affleure, non pas celle qui séduit par l’éclat, mais celle qui porte en silence une vérité. Une beauté qui ne cherche pas à convaincre mais à tenir, qui émerge d’un lieu aligné. Comme si, à certains moments, la forme juste devenait capable, discrètement, de sauver quelque chose, et peut-être même le monde…
Cette beauté discrète, loin d’être un supplément, devient alors un principe structurant. C’est ce que Maître Kong, dans les Entretiens, désigne cette sincérité par le terme chéng, une honnêteté invisible, présente dans chaque geste accompli sans surjeu. Au sein de l’environnement numérique, cela implique que l’engagement utilisateur naît d’une constance, non spectaculaire mais rigoureuse, entre la forme et l’intention.
Les marques qui échouent ici n’ont pas forcément “mal fait”. Elles ont oublié que dans une sémiotique du numérique, tout fait signe, même l’oubli. À l’inverse, celles qui cultivent un récit incarné jusque dans les marges de l’interface tissent une relation durable, non par le spectaculaire, mais par le narrative microdesign.
3.3 – Gouverner le récit à l’ère IA : entre orientation éthique et structure opératoire
Comment piloter une production narrative à grande échelle sans perdre mon identité de marque ?
C’est là le défi ultime des stratégies éditoriales contemporaines. À l’heure des contenus massifs, des prompts génératifs et de l’automatisation des formats, la tentation est grande de céder à l’efficacité. Mais la gouvernance narrative, aujourd’hui, ne consiste pas à tout produire ; elle consiste à tout orienter.
Peter Drucker parlait d’un management par finalité : structurer non pour produire, mais pour exprimer une intention. La gouvernance du contenu, dans cette perspective, ne repose pas sur l’abondance de ressources, mais sur la clarté du lieu d’où l’on parle. Produire du texte ne suffit pas. Il faut produire depuis une position éthique, même dans l’automatisation.
Watsuji Tetsurō, dans Fūdo, rappelle que toute forme d’expression s’inscrit dans un lieu, au sens symbolique et environnemental. La technique, même neutre en apparence, porte toujours une orientation. Une IA non encadrée produit du langage ; une IA encadrée par des AI tonebooks peut prolonger une voix. Ce n’est pas une question de maîtrise technique, mais de fidélité morale.
Certaines entreprises structurent désormais leur production autour d’indicateurs symboliques, NAS (Narrative Alignment Score), BII (Brand Inconsistency Index),… , qui ne mesurent pas la performance brute, mais la cohérence. Ces symbolic KPIs deviennent la boussole d’une automatisation responsable.
Le cas Patagonia illustre cette cohérence structurelle dans l’automatisation : les récits sur les vêtements réparés, les mails, les fiches, les appels aux dons ; tout se tient. Chaque élément prolonge le même geste narratif. Ce n’est pas une stratégie de contenu. C’est une fidélité vivante.
À l’inverse, J.Crew, lors de sa tentative de repositionnement en 2018, a brisé le fil. Loin de sa promesse de classicisme élégant, la marque a voulu paraître jeune, branchée, décalée. Résultat : rupture de récit, perte de repères, incohérence entre supports. Le récit a été produit, mais il n’était plus gouverné.
Yagyū Munenori, maître d’arts martiaux, le formulait autrement : gouverner, ce n’est pas imposer ; c’est structurer un geste qui se tient sans forcer. La cohérence n’est pas une discipline externe, mais un lieu de parole intérieure.
A une époque, où la narration devient aussi technique qu’humaine, gouverner le récit, c’est créer un espace symbolique où la forme reste fidèle à l’intention. Et même dans l’ère des contenus IA, il reste possible de raconter, sans trahir.
Conclusion : Ce n’est pas le récit qui compte, mais le lieu d’où il parle
Le design narratif n’est pas un outil de coordination, encore moins un supplément esthétique à l’expérience utilisateur. Il est un acte. Un acte de positionnement, de responsabilité, de cohérence éthique. Car dans l’économie symbolique contemporaine, ce n’est pas tant ce que l’on raconte qui importe, mais d’où l’on parle. Le récit digital devient crédible non par sa fluidité, mais par la densité du basho ; ce « lieu habité » à la fois éthique, structurel et symbolique, dans lequel il prend racine.
Un storytelling éthique ne cherche pas à séduire ; il cherche à être fidèle. Fidèle à une intention fondatrice, à une voix, et donc fidèle à un espace de sens partagé. Cette fidélité ne s’impose pas, elle se travaille. Elle se joue dans chaque détail, chaque micro-interaction, chaque tension entre automatisation et humanité. Et surtout, elle se construit dans le temps : par reprises ajustées, par gestes alignés, par une rigueur tranquille qui traverse les dispositifs sans jamais céder au bruit ambiant.
Ce que nous avons exploré ici n’est donc pas une méthode de marketing narratif, mais une posture. Un marketing narratif qui ne réduit pas la narration à une mise en scène persuasive, mais qui la pense comme une forme d’éthique située, une manière d’habiter le langage, de gouverner la cohérence, d’assumer un lieu. La voix de marque n’est pas un ton, mais une tension : entre la continuité et le contexte, entre la promesse et l’usage, entre le message et le geste.
Dans cette optique, la responsabilité narrative devient la boussole. Ce n’est pas à la structure seule de garantir la pertinence, ni à la technologie seule de produire la parole. C’est à l’organisation, dans sa globalité, de construire une architecture signifiante, soutenue par des choix clairs, des limites assumées, et un travail rigoureux sur les formes. Car tout design narratif, pour durer, doit porter une incarnation symbolique lisible, non pas une perfection formelle, mais une justesse vécue.
Dans un monde saturé de récits interchangeables, seules les voix alignées résistent. Et seule une cohérence éthique, discrète, mais structurante, peut faire du récit un acte habité, capable de transmettre plus qu’un message : une orientation, un sens, un engagement.
Si vous souhaitez mettre en place une stratégie de storytelling éthique alignée avec les valeurs de votre entreprise, je vous invite à remplir le formulaire de contact pour convenir d’un rendez-vous avec Richard Bulan. Ensemble, faisons en sorte que votre récit parle depuis un lieu juste.
BONUS : Méthode d’audit du basho narratif – 4 étapes pour diagnostiquer la cohérence de votre organisation
- Cartographie des voix – Audit des points de contact et identification des incohérences discursives
- Archéologie narrative – Recherche du récit fondateur et des ruptures historiques
- Test de performativité – Évaluation de l’écart entre promesse narrative et expérience vécue
- Ancrage symbolique – Définition du lieu de cohérence et des principes de gouvernance
FAQ
Une rupture de basho, ce lieu symbolique qui donne au récit sa cohérence, se manifeste par une dissonance entre le discours de la marque et les formes par lesquelles il est porté. Elle peut surgir d’un prompt IA mal calibré, d’une charte graphique déclinée sans conscience du contexte, ou d’une campagne qui trahit l’intention fondatrice au nom de la tendance. Le symptôme n’est pas l’erreur visible. Cependant, c’est le trouble diffus : l’impression que « quelque chose sonne faux », que l’on communique sans habiter ce que l’on dit. Un bon diagnostic repose donc moins sur l’audit de performance que sur l’écoute fine de la cohérence symbolique : voix, gestes, formats et finalité doivent parler d’un même lieu.
Le storytelling classique vise souvent la persuasion par la mise en intrigue : captiver, émouvoir, convaincre. La narration éthique, elle, ne cherche pas l’effet, mais la tenue. Elle s’ancre dans une fidélité structurelle et une responsabilité narrative : dire ce que l’on est, non ce qui fonctionne. Là où le storytelling classique peut manipuler les signes pour maximiser l’engagement, la narration éthique les aligne sur une intention durable. Elle n’est pas un décor, mais un engagement moral : celui d’incarner ce que l’on affirme.
Oui, mais à une condition : être gouvernée. L’IA narrative sans cadre produit du langage, pas nécessairement du sens. Ce n’est pas l’automatisation en soi qui altère l’authenticité, mais l’absence de basho, c’est-à-dire d’un lieu symbolique d’énonciation. Une IA bien encadrée par des tonebooks, des indicateurs comme le NAS ou le BII, et une stratégie de contenu claire, peut prolonger une voix. Mais elle ne l’invente pas. Elle ne fait qu’écho. L’authenticité ne réside pas dans la technique, mais dans l’origine éthique du message.
La clé réside dans une architecture de sens plus que dans un planning de production. Avant de produire, il faut clarifier : d’où parlons-nous, pourquoi, avec quelle orientation ? Cela implique de définir un récit fondateur, de poser des invariants symboliques (gestes, tons, temporalités), et de s’outiller, non seulement avec des process, mais avec des indicateurs symboliques. La gouvernance narrative devient alors une forme d’éthique opératoire, où chaque contenu n’est pas une tâche, mais un acte de fidélité.
Oui, à condition de ne pas la maquiller. L’erreur serait de la corriger par un simple rebranding cosmétique. La réparation narrative suppose une reprise signifiante : reconnaître le décalage, identifier le lieu d’origine, et rejouer le récit à partir de là. Cela peut passer par une série de gestes concrets : reformulation éditoriale, redesign UX, prises de parole assumées. Mais la clé reste toujours la même : ne pas chercher à réécrire l’histoire, la réhabiter.