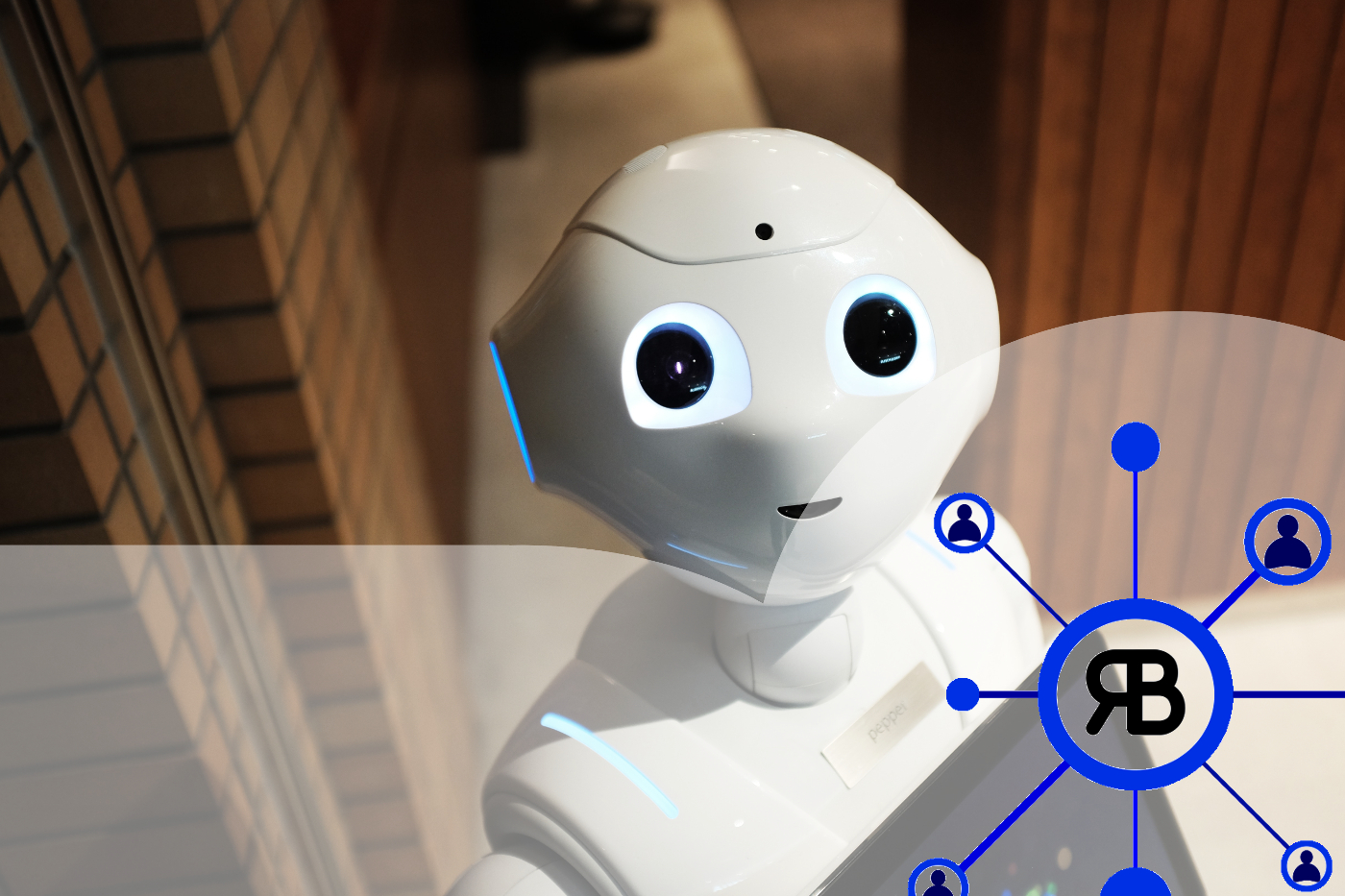Introduction
Vous vivez dans un monde où l’obsession pour le data-driven est devenue une norme. Chaque tableau de bord promet de réduire l’incertitude, chaque KPI se présente comme une boussole objective, chaque algorithme rassure en prétendant transformer la complexité en clarté. L’illusion est séduisante : plus vous accumulez de données, plus vous croyez maîtriser votre environnement. Mais cette promesse de transparence recèle une fragilité silencieuse : elle confond la mesure avec le sens, l’indicateur avec la finalité.
La donnée, bien sûr, est indispensable. Elle constitue un langage commun, un socle de preuves, une matière première pour vos décisions. Pourtant, elle reste incomplète. Elle ne dit rien de l’orientation à prendre, rien de la fidélité à vos valeurs, rien de la vision qui doit animer votre action. Comme le rappelle Karl Weick, ce ne sont pas les faits en eux-mêmes qui guident une organisation, mais le sens que vous leur donnez. Une gouvernance purement algorithmique vous expose au risque de l’aveuglement : vous croyez piloter, alors que vous ne faites que suivre des chiffres.
C’est précisément pour répondre à ce défi que nous avons conçu EIDÔLON, un programme d’accompagnement destiné aux CMO et directeurs marketing qui veulent transformer leurs données en véritable avantage concurrentiel. Car ce n’est pas l’abondance de données qui produit de l’intelligence, mais la capacité à les structurer, à les interpréter et à les inscrire dans une logique de décision habitée. EIDÔLON ne se limite pas à l’optimisation des dashboards : il redonne à vos données une orientation stratégique, en les articulant à votre vision et à vos choix de gouvernance.
Dans un contexte où la culture data-driven s’impose comme norme, la véritable question est la suivante : comment éviter que votre entreprise ne se perde dans l’illusion d’objectivité des chiffres ? Comment intégrer la puissance des données sans réduire votre stratégie à une mécanique d’optimisation locale ? Comment redonner au jugement, à l’interprétation et à la responsabilité la place qu’ils méritent dans vos choix ?
Pour explorer cette question, nous analyserons d’abord la promesse et les limites de la donnée comme fondement stratégique. Nous verrons ensuite pourquoi la donnée, sans contexte ni interprétation, ne peut suffire, et comment la replacer dans un horizon de jugement et de responsabilité. Enfin, nous montrerons comment construire une gouvernance éclairée, capable de croiser la rigueur quantitative avec l’intelligence qualitative, et d’inscrire vos décisions dans une culture durable de discernement.
I. La promesse et les limites de la donnée comme fondement stratégique
A. La fascination data-driven et ses illusions
Le data-driven mindset s’est imposé dans vos organisations comme un horizon indiscutable. Vous vous y accrochez parce qu’il donne l’impression de rationaliser l’incertitude : chaque décision semble pouvoir être adossée à un chiffre, chaque orientation validée par un indicateur. Cette logique rassure, car elle substitue au doute une apparence de certitude. Pourtant, ce confort est trompeur : ce que vous appelez objectivité repose sur une construction qui oublie ses propres présupposés.
La gouvernance par la donnée fonctionne comme un double déplacement. D’un côté, elle prétend aligner l’action sur des fondations solides (indicateurs de performance, modèles d’attribution, frameworks comme l’AARRR) en donnant à croire que tout peut être mesuré, comparé, optimisé. De l’autre, elle déplace l’attention de la finalité vers la métrique. Vous ne pilotez plus vos décisions par rapport à vos objectifs réels, mais par rapport aux instruments censés les représenter. Peter Drucker l’avait déjà signalé : ce que vous mesurez finit toujours par orienter ce que vous gérez, au risque de confondre la carte et le territoire.
C’est précisément ce glissement qui nourrit la fascination data-driven. La donnée produit l’illusion d’une objectivité immédiate : elle semble se suffire à elle-même, comme si les chiffres contenaient en eux leur propre signification. Karl Weick a montré combien cette illusion est fragile : aucune donnée n’existe à l’état brut. Ce que vous appelez « fait » est déjà le résultat d’un choix, d’une sélection, d’une catégorisation. En croyant voir la réalité, vous ne regardez qu’une découpe rendue visible par vos systèmes. Chesterton aurait dit qu’il s’agit d’une « superstition moderne » : non plus croire aux dieux, mais croire aux chiffres. Pascal, dans une autre langue, rappelait que la carte ne peut jamais être le territoire : elle rassure, elle oriente, mais elle réduit toujours.
C’est ici qu’intervient le piège des vanity metrics. Elles séduisent vos équipes parce qu’elles sont faciles à mesurer, parce qu’elles progressent rapidement, et parce qu’elles flattent l’idée que vous contrôlez la situation. Mais elles ne disent rien de la valeur réelle que vous créez. Un nombre de vues, de likes ou de téléchargements peut donner le sentiment d’un progrès, alors qu’il ne traduit ni engagement durable ni avantage concurrentiel. Ces métriques sont vaniteuses parce qu’elles donnent une illusion de vitalité, alors qu’elles ne font que mesurer le reflet de votre activité. En intelligence économique, elles fonctionnent comme des leurres : elles captent votre attention, mais elles masquent les signaux faibles, ces indices ténus qui portent pourtant les vraies orientations stratégiques.
Un exemple concret l’illustre. Pierre Fournier rapporte que chez ManoMano, l’une des équipes produit avait choisi comme North Star Metric le volume de recherches internes. La logique paraissait imparable : un site plus pertinent devait inciter davantage de visiteurs à utiliser la barre de recherche. Pourtant, ce KPI s’est révélé trompeur : il pouvait être artificiellement amélioré par de simples changements esthétiques (une barre plus visible ou plus grande), sans que l’expérience utilisateur ne progresse réellement. L’entreprise croyait mesurer la pertinence, elle ne mesurait que l’usage d’un dispositif. C’est exactement la logique des vanity metrics : elles capturent un phénomène superficiel, mais elles échouent à rendre compte de ce qui compte vraiment.
Vous êtes donc placé devant une tension structurelle : la donnée attire parce qu’elle simplifie et réduit l’incertitude, mais cette réduction installe une fragilité silencieuse. Elle vous donne la sensation de piloter votre organisation, alors qu’elle renforce en réalité vos angles morts. La véritable gouvernance de la donnée consiste à distinguer entre des métriques qui flattent et des indicateurs qui éclairent. Sans ce discernement, vous risquez de confondre un tableau de bord séduisant avec une boussole stratégique. Et comme le rappellent Weick, Drucker, Pascal et Chesterton chacun à leur manière, ce n’est jamais la mesure en elle-même qui oriente : c’est l’histoire que vous construisez à partir d’elle, et la capacité à reconnaître ce qu’elle révèle… ou dissimule.
B. Quand la donnée se trompe : erreurs, biais et métriques vaines
L’un des dangers majeurs du data-driven mindset est que vos données peuvent être fausses, incomplètes ou biaisées. Ce risque est plus fréquent que vous ne l’imaginez. Pierre Fournier en donne un exemple éclairant avec ManoMano : une simple modification technique lors d’une migration a faussé les pixels de conversion. Les dashboards continuaient d’afficher des chiffres, mais ces chiffres ne correspondaient plus à la réalité. Garbage in, garbage out.
C’est ici que la rigueur devient essentielle. Une politique de data governance claire, définition des métriques, propriété des données, qualité des flux, ne relève pas du luxe, mais d’une condition de survie. Sans elle, vous confondez activité et vérité. Les biais méthodologiques, eux aussi, minent vos analyses : protocoles mal définis, échantillons insuffisants, ou encore erreurs d’attribution. L’étude scientifique « A Validity Perspective on Evaluating the Justified Use of Data-driven Decision-making Algorithms » publiée en 2022 a mis en évidence un point décisif : les biais ne sont pas seulement des « erreurs » ponctuelles, ils traversent tout le processus de constitution et d’utilisation des datasets. L’illusion d’objectivité algorithmique repose sur une confiance excessive dans la donnée brute, sans interroger les conditions de sa validité.
Les auteurs distinguent plusieurs formes de validité. La validité de construction interroge la pertinence des indicateurs : un KPI peut sembler cohérent tout en ne mesurant pas ce qu’il prétend mesurer ; par exemple, un taux de clics assimilé à un indicateur d’engagement, alors qu’il traduit souvent une simple curiosité éphémère. De plus, la validité interne renvoie à la solidité du protocole expérimental : un AB test fondé sur des échantillons biaisés peut produire une corrélation qui ne reflète en rien la réalité. La validité externe questionne la généralisation : un modèle qui prédit correctement le comportement d’utilisateurs dans un contexte précis peut se révéler inopérant dès que l’environnement change. Enfin, la validité écologique rappelle que tout indicateur doit être replacé dans la complexité réelle : sinon, il construit une fiction opératoire.
Un exemple concret de l’étude illustre ce danger. Dans certains contextes, des entreprises utilisent des données de performance scolaire ou professionnelle pour entraîner des modèles de recrutement. Or, les variables retenues (notes, diplômes, historique d’emploi) sont présentées comme neutres, mais elles intègrent en réalité des biais structurels liés au contexte d’origine (système éducatif, critères culturels, opportunités locales). Le modèle, lorsqu’il est appliqué à un autre environnement, échoue totalement : ce qui apparaissait comme un indicateur fiable dans un cadre donné devient non pertinent ailleurs. La validité externe est compromise, et l’organisation prend des décisions biaisées en croyant disposer d’un jugement rationnel.
Autrement dit, vos datasets peuvent être impeccables d’un point de vue technique et pourtant profondément biaisés dans leur capacité à informer la décision. Comme le rappellent Karl Weick et Paul Ricœur, toute information est déjà une mise en intrigue, une interprétation située. En pratique, vos algorithmes reproduisent et amplifient des angles morts : une variable mal définie ou un protocole trop restreint ne produisent pas seulement une erreur ponctuelle, mais construisent un aveuglement systémique. Vous croyez travailler avec un instrument de précision ; en réalité, vous manipulez un miroir déformant.
De plus, la typologie des validités proposée dans l’étude (construction, interne, externe, écologique) éclaire de manière précise les fragilités du data-driven mindset. Mais ce constat trouve une profondeur supplémentaire lorsqu’on le met en perspective avec la critique philosophique du réductionnisme. Chacune de ces formes de validité résonne avec une exigence théorique qui dépasse largement le champ technique et touche à la manière dont nous comprenons ce qu’est une vérité opérationnelle.
La validité de construction nous ramène à Paul Grice. Dans sa théorie de la communication, il montre que tout échange repose sur des implicites : ce qui est dit n’épuise pas ce qui est signifié. Transposé au domaine de la donnée, cela signifie que ce que vous mesurez n’est jamais parfaitement identique à ce que vous croyez évaluer. Un taux de clics ne dit pas l’engagement, pas plus qu’un nombre de vues ne dit l’attention. Derrière chaque indicateur se cache une équivoque, un décalage entre le signe et le sens. La donnée, loin d’être un miroir du réel, est une approximation construite qui risque toujours de figer une interprétation implicite en prétendue objectivité.
La validité interne et externe, quant à elles, rejoignent les analyses de Karl Weick sur le sensemaking. Weick rappelle que tout processus d’interprétation est situé : il s’enracine dans un contexte organisationnel, culturel, temporel. Un protocole expérimental peut sembler rigoureux dans un cadre donné, mais il perd sa pertinence dès qu’il est déplacé. C’est précisément la fragilité de la généralisation : croire qu’un modèle prédit des comportements universels alors qu’il ne fait que répéter un sens construit dans une situation singulière. Là où l’entreprise voit une règle, elle ne dispose en réalité que d’un récit contextualisé. L’illusion d’objectivité masque le caractère provisoire et contingent de tout savoir empirique.
Enfin, la validité écologique trouve une résonance directe chez Paul Ricœur. Pour lui, toute information isolée n’est qu’un fragment : elle n’acquiert sa valeur qu’en étant reliée à d’autres éléments dans une « mise en intrigue ». La narration n’est pas un habillage secondaire, elle est la condition de possibilité du sens. Transposée à la donnée, cette idée rappelle que les métriques brutes, si sophistiquées soient-elles, ne disent rien par elles-mêmes. Ce n’est qu’en les articulant dans un récit stratégique, reliant objectifs, contextes et finalités, qu’elles deviennent signifiantes. Faute de cette narration, elles se réduisent à des artefacts techniques, des fragments déconnectés qui peuvent impressionner par leur précision mais qui demeurent creux.
Ainsi, la grille de lecture des validités, loin d’être un simple outil méthodologique, révèle une vérité plus profonde : la donnée ne vaut jamais par elle-même. Elle est toujours interprétation, toujours située, toujours fragmentaire. Grice nous rappelle la fragilité de la signification, Weick insiste sur le caractère contextuel de toute interprétation, Ricœur souligne la nécessité de relier les fragments dans une histoire cohérente. Ensemble, ils dessinent une même critique : celle d’un réductionnisme qui croit pouvoir s’affranchir du langage, du contexte et du récit, alors que ce sont précisément eux qui donnent à la donnée sa valeur stratégique.
Vous pouvez donc multiplier les dashboards, mais si vos métriques sont mal choisies ou si vos sources sont contaminées, vous ne faites qu’amplifier une illusion. La fiabilité ne se gagne pas par la quantité, mais par le discernement. La donnée n’est utile que lorsqu’elle est éprouvée, nettoyée, confrontée à son contexte.
C. Optimiser sans voir : le piège de l’AB testing et de l’optimisation locale
L’AB testing et ses déclinaisons multivariées sont devenus pour vous des réflexes méthodologiques. Ils offrent une apparente sécurité : comparer, mesurer, trancher. En réduisant la décision à une série de choix binaires, ils donnent le sentiment que l’incertitude peut être dissoute dans la précision statistique. Mais cette logique engendre une illusion de maîtrise : vous croyez avancer, alors que vous ne faites que tourner autour de variations locales, prisonnier d’un champ expérimental restreint.
Le piège tient à la structure même de ces tests. Ils évaluent des écarts immédiats, mais ils ne disent rien de l’orientation globale. Vous pouvez optimiser indéfiniment la couleur d’un bouton, l’ordre d’un menu, la taille d’une bannière, sans jamais interroger la cohérence de l’expérience proposée. C’est le paradoxe de l’optimisation locale : chaque micro-décision semble rationnelle, mais l’ensemble reste aveugle, faute de finalité explicite. Vous poursuivez des gains marginaux sans vous demander si ces gains participent à votre projet stratégique.
Ce mécanisme d’aveuglement est connu en philosophie pratique. La phronèsis aristotélicienne désignait précisément la capacité de tenir compte non seulement des moyens, mais de la finalité de l’action. Réduire la décision à une suite de tests quantitatifs revient à vider cette prudence de son sens, à confondre l’exactitude locale avec la justesse globale. Kierkegaard, de son côté, rappelle que la répétition véritable n’est pas une reproduction mécanique, mais une recréation signifiante : rejouer une intention fondatrice dans un contexte nouveau. Transposé à vos pratiques marketing, cela signifie que vos expérimentations n’ont de valeur que si elles prolongent une orientation cohérente, et non si elles s’accumulent sans autre horizon que l’optimisation elle-même.
C’est là que la critique de Jim Collins trouve sa pertinence. Une entreprise qui se contente de micro-améliorations perpétuelles évite d’affronter les réalités dures, les brutal facts, qui exigent une refonte en profondeur. Vous pouvez multiplier les AB tests et accumuler des « victoires » locales, mais si vous ne regardez pas en face les problèmes structurels, manque de clarté dans votre proposition de valeur, incohérence dans votre parcours client, absence de différenciation stratégique, ces optimisations ne font que masquer l’essentiel.
Se dessine alors une même logique, qu’Aristote, Kierkegaard et Collins permettent de comprendre ensemble : l’obsession de l’expérimentation locale réduit la stratégie à un calcul mécanique, là où elle devrait être un art du jugement orienté. La véritable rationalité ne réside pas dans la succession de tests partiels, mais dans la capacité à interpréter leurs résultats dans une histoire plus vaste, celle de votre produit, de votre marché, de vos valeurs. Sans ce récit qui relie les fragments, vous ne faites que perfectionner un labyrinthe, sans jamais en trouver la sortie.
Ainsi, l’exemple rapporté par Pierre Fournier est éclairant : LinkedIn, en refondant sa page de tarification, avait vu les premiers résultats chuter brutalement. Un AB test classique aurait conduit à conclure à l’échec. Mais l’entreprise a maintenu sa nouvelle version, convaincue qu’elle correspondait mieux à sa stratégie. Quelques mois plus tard, les résultats avaient largement dépassé ceux de l’ancienne interface. Ce cas montre que l’optimisation locale n’est pas toujours un critère fiable : le temps, la vision et la cohérence avec la finalité priment sur la seule mesure instantanée.
L’AB testing et les micro-indicateurs du funnel AARRR sont des outils utiles, mais seulement s’ils restent inscrits dans une orientation plus vaste. Leur danger est de transformer la stratégie en mécanique de petits gains, sans profondeur ni vision. C’est en cela que l’optimisation locale devient un piège : elle donne l’illusion de progresser alors qu’elle détourne de l’essentiel. La véritable stratégie, comme le rappellent Kierkegaard, Aristote et Collins chacun à leur manière, consiste à affronter les faits, à exercer la prudence, et à maintenir une orientation habitée, au-delà du confort des chiffres immédiats.
En définitive, qu’il s’agisse des vanity metrics qui flattent sans éclairer, des biais qui contaminent vos jeux de données, ou des optimisations locales qui réduisent votre horizon, la tentation data-driven révèle toujours le même écueil : confondre la mesure avec la finalité. La donnée n’est jamais une vérité en soi, mais un fragment qui doit être replacé dans un récit stratégique. L’enjeu, dès lors, n’est pas de renoncer aux chiffres, mais de les réinscrire dans une logique d’interprétation.
C’est ce déplacement que nous explorerons dans la partie suivante : comment dépasser la donnée brute pour la replacer dans un cadre de sens, de jugement et de contexte.
II. Au-delà de la donnée : interprétation, jugement et contexte
A. La donnée sans contexte ne fait pas sens
Un indicateur isolé, un taux de clics, un volume de recherche ou un coût par lead, ne vaut rien tant qu’il n’est pas replacé dans un environnement qui lui donne sens. Vous pouvez le présenter dans un dashboard impeccable, il ne vous dira rien de vos clients si vous ne l’interprétez pas dans le cadre de leurs usages réels. C’est la première limite du pilotage exclusivement chiffré : croire que l’information se suffit à elle-même, alors qu’elle n’est qu’un fragment.
Dans le travail de veille stratégique, vous le savez, l’enjeu n’est jamais la collecte brute mais l’interprétation. Les données disponibles en open source, par exemple, ne révèlent leur intérêt que lorsqu’elles sont croisées, confrontées, reliées à d’autres sources. C’est ce que souligne Karl Weick : la donnée n’a pas de sens en soi, elle devient intelligible par le sensemaking, ce processus collectif où l’organisation construit une signification partagée. L’intelligence économique ou le data marketing n’est donc pas affaire de chiffres accumulés, mais d’orientation donnée aux chiffres.
Cela suppose de replacer chaque métrique dans un « lieu » qui la relie à la totalité du système que vous observez. La notion de basho formulée par Nishida l’exprime avec force : aucun élément ne vit isolé, il appartient toujours à un champ qui l’accueille et lui donne sa consistance. En marketing comme en IE, cela signifie qu’un KPI ne vaut que par son inscription dans votre écosystème de marché, vos canaux de distribution, vos comportements clients. Le chiffre brut n’est pas faux : il est incomplet tant que vous n’avez pas défini le lieu qui en éclaire la portée.
Paul Ricœur, de son côté, nous aide à comprendre ce travail par l’image de la « mise en intrigue ». Une donnée n’a de valeur stratégique que si elle est reliée à d’autres pour former une narration cohérente : un parcours client, une évolution de marché, un scénario concurrentiel. Quand vous bâtissez un dashboard efficace, vous ne vous contentez pas d’aligner des courbes : vous composez une architecture narrative qui relie le passé observé, le présent mesuré et le futur anticipé. La « philosophie du dashboard » l’a bien montré : un tableau de bord n’est pas un entrepôt de chiffres, c’est une scène sur laquelle se joue la compréhension collective.
C’est pourquoi les pratiques les plus solides d’OSINT et de veille qualitative privilégient toujours le recoupement et l’analyse contextuelle. Un signal faible peut sembler insignifiant isolément, mais il devient décisif une fois relié à d’autres indices. L’erreur serait de croire qu’une métrique suffit à éclairer l’action ; la vérité est qu’elle ne vaut que replacée dans une histoire, un lieu et une interprétation.
En somme, la donnée n’est pas un miroir du réel, mais une matière à interpréter. Elle n’éclaire vos décisions que si vous acceptez de la lire dans un contexte, comme fragment d’un récit, inscrit dans un lieu, intégré à une dynamique collective. Sans ce travail, vos chiffres ne sont que des reflets séduisants, incapables de guider vos choix.
B. Le discernement face aux biais : prudence et responsabilité
Une fois admis que vos données sont traversées de biais et que vos indicateurs ne reflètent jamais parfaitement la réalité, la question décisive n’est plus seulement technique. Elle devient éthique et stratégique : comment décider malgré l’incertitude, comment orienter vos choix sans céder à l’illusion d’objectivité ?
C’est ici qu’intervient ce que la tradition philosophique appelle le discernement. Aristote parlait de phronèsis, cette prudence pratique qui n’oppose pas les moyens et les fins mais les tient ensemble. En marketing digital, cela signifie que vous ne pouvez pas vous contenter d’optimiser un KPI localement, ni de corriger un biais par un ajustement statistique : vous devez constamment interroger la finalité stratégique derrière l’indicateur. Une campagne à faible coût d’acquisition peut sembler performante ; mais si elle attire des prospects hors de votre cœur de marché, la métrique aura servi un but trompeur. La prudence consiste à voir au-delà du chiffre, à se demander : « sert-il vraiment mon objectif ? »
Kierkegaard, de son côté, éclaire cette exigence sous un autre angle : chaque décision est un choix existentiel. Dans vos comités de pilotage, vous êtes souvent tenté de repousser l’engagement derrière un chiffre, comme si l’indicateur décidait à votre place. Mais il ne fait que repousser l’échéance du choix. Décider de maintenir une stratégie malgré un AB test défavorable, ou au contraire d’interrompre une campagne pourtant rentable à court terme mais nocive pour votre image, relève de ce choix assumé que Kierkegaard décrit : agir sans garantie absolue, en orientant vos décisions au nom d’une cohérence plus profonde que les métriques.
Enfin, Hans Jonas nous rappelle que la responsabilité ne se mesure pas seulement à l’efficacité immédiate, mais à l’anticipation de ses effets à long terme. Les biais de vos algorithmes, vous le savez, ne disparaissent pas : ils se diffusent dans vos modèles d’attribution, vos segmentations, vos politiques de ciblage. Un KPI peut être exact dans ses calculs, mais destructeur dans ses conséquences si, par exemple, il renforce des comportements discriminants ou pousse vos équipes à exploiter abusivement un canal à court terme. L’exigence de Jonas est claire : toute décision technique engage une responsabilité élargie, qui doit inclure les effets invisibles et différés.
Le discernement face aux biais ne consiste donc pas à rêver d’une donnée parfaitement neutre, mais à apprendre à juger dans l’incertitude. C’est la condition d’un pilotage vraiment stratégique : intégrer les chiffres sans leur déléguer la décision, reconnaître les biais sans se paralyser, et orienter l’action en gardant la finalité comme boussole. C’est seulement ainsi que vos indicateurs, imparfaits par nature, peuvent devenir des appuis de responsabilité plutôt que des machines à fabriquer des illusions.
C. De la donnée brute à la parole performative
Un chiffre, aussi précis soit-il, ne produit aucun effet s’il n’est pas porté par un langage. Vos dashboards peuvent accumuler des colonnes de données, mais tant qu’ils ne sont pas traduits en une parole qui engage vos équipes, ils restent inertes. Le véritable enjeu de la donnée est là : non pas seulement représenter, mais agir par le langage, transformer l’information en décision et en orientation.
C’est ce que J. L. Austin avait montré avec sa théorie des actes de langage : dire, c’est faire. Dans vos comités, lorsqu’un directeur marketing déclare qu’un canal est « prioritaire » ou qu’une campagne doit être « arrêtée », il ne se contente pas de décrire une situation, il change la réalité opérationnelle. De même, lorsqu’un KPI est présenté dans un reporting, sa valeur ne vient pas seulement du chiffre affiché, mais de la manière dont il est interprété et performé dans l’organisation. François Cooren prolonge cette intuition en montrant que toute communication, même en entreprise, est déjà un acte : vos données deviennent des décisions dès qu’elles sont formulées dans un cadre collectif.
C’est pourquoi le data storytelling est devenu une pratique incontournable. Présenter un taux de conversion ou une évolution de trafic ne suffit pas ; vous devez les inscrire dans un récit stratégique qui articule le passé, le présent et le futur. Paul Ricœur nous aide à comprendre cette exigence : l’identité d’une organisation se construit dans une « mise en intrigue » où les événements isolés sont reliés en une histoire cohérente. Sans ce récit, vos données ne sont que des fragments déconnectés ; avec lui, elles deviennent un levier de mobilisation et de projection.
La pertinence de ce récit ne repose pas uniquement sur ce qui est dit, mais aussi sur ce qui est sous-entendu. Paul Grice, en analysant les implicites de la communication, a montré que nous comprenons toujours plus que ce qui est formulé. En stratégie marketing, cela signifie que vos données doivent être présentées de manière contextuelle, en tenant compte de ce que vos interlocuteurs attendent, supposent ou craignent. Un graphique sur la baisse d’un indicateur n’a pas le même effet s’il est annoncé comme un risque à anticiper ou comme une opportunité de transformation. La donnée, dans ce cas, devient un vecteur de persuasion autant qu’un outil d’information.
C’est là que se joue la gouvernance narrative. Vous ne pilotez pas vos équipes en accumulant des métriques, mais en donnant une voix aux chiffres, en les transformant en engagements. L’OSINT qualitatif fonctionne de la même manière : une information issue d’une source ouverte n’a de valeur que replacée dans un récit qui lui donne cohérence et portée. C’est ce que souligne le travail sur l’éthique du récit et le design narratif : la donnée ne devient action que lorsqu’elle est incarnée dans une parole située, qui engage une responsabilité et ouvre une perspective.
En somme, vos données ne sont pas seulement des preuves à collecter : elles sont des actes à proférer. C’est en les inscrivant dans un récit stratégique, en respectant leur pertinence contextuelle, que vous passez de la donnée brute à la décision habitée. Autrement dit, ce n’est pas le chiffre qui transforme l’organisation, mais la parole qui le porte et qui, en le performant, engage votre avenir.
En définitive, la donnée n’acquiert de valeur qu’en étant replacée dans un contexte, éprouvée par le discernement et transformée en parole performative. Sans ce travail d’interprétation, de prudence et de récit, elle reste un fragment inerte, incapable de guider vos choix. L’enjeu n’est donc pas d’opposer données et jugement, mais de les articuler pour que vos chiffres deviennent des décisions assumées. La partie suivante montrera comment inscrire cette articulation dans une véritable gouvernance éclairée de la donnée, capable de relier la rigueur quantitative à l’intelligence qualitative.
III. Vers une gouvernance éclairée de la donnée
A. Croiser quantitatif et qualitatif pour mieux décider
Décider sur la seule base de chiffres, c’est vous condamner à voir toujours la même chose : ce que vos modèles ont déjà décidé de mesurer. À l’inverse, vous limiter à l’observation qualitative vous expose au risque de rester dans l’intuition, sans preuve ni portée opérationnelle. C’est pourquoi la véritable stratégie se construit dans l’hybridation : relier la force du quantitatif et la profondeur du qualitatif pour bâtir une décision réellement data-informed.
En intelligence économique, cette approche d’analyse mixte n’est pas un luxe, mais une nécessité. Un indicateur de performance peut signaler une baisse, mais c’est l’enquête de terrain, l’OSINT qualitatif ou l’étude des usages qui en révèlent la cause. Pierre Fournier le montre bien : chez ManoMano, le constat d’une fuite d’utilisateurs vers Google n’a pas émergé d’un dashboard, mais de l’observation des comportements clients. Les chiffres ne révélaient rien ; c’est le qualitatif qui a permis de donner sens aux données, puis de les réinterpréter. Inversement, un insight qualitatif peut rester à l’état d’hypothèse tant qu’il n’est pas mesuré. L’exploration d’un ressenti client ou d’un signal faible gagne en solidité dès lors qu’elle est appuyée par une quantification rigoureuse.
Cette complémentarité rejoint la réflexion de Hans Joas sur les valeurs émergentes. Pour lui, ce ne sont pas des systèmes théoriques qui produisent nos engagements, mais l’expérience vécue, réinterprétée dans l’action. En stratégie marketing, c’est la même dynamique : une donnée brute ne dicte pas la décision, mais l’expérience de vos clients, traduite en indicateurs, fait émerger une orientation nouvelle. La valeur d’une donnée ne réside donc pas dans son existence isolée, mais dans sa capacité à entrer en résonance avec d’autres formes de connaissance pour créer du sens.
Paul Ricœur nous aide ici à comprendre ce travail d’articulation. Croiser quantitatif et qualitatif, c’est construire ce qu’il appelle des mémoires croisées : relier différents fragments, issus de registres hétérogènes, pour en faire une histoire cohérente. Vos dashboards, vos verbatims clients, vos études de marché et vos analyses OSINT ne sont pas des silos, mais des morceaux d’une même narration. C’est en les confrontant que vous évitez à la fois l’aveuglement statistique et l’arbitraire subjectif.
L’article de TechRadar sur le dark data le souligne : la valeur ne vient pas des masses de données que vous accumulez, mais de votre capacité à transformer ce qui reste invisible en intelligence stratégique. Or, cette transformation suppose précisément de croiser les approches : donner une voix qualitative aux chiffres muets, et une assise quantitative aux intuitions du terrain.
En définitive, ce croisement n’est pas une juxtaposition, mais une logique de découverte. Vous ne cherchez pas à confirmer mécaniquement vos hypothèses, mais à faire émerger des sens nouveaux à l’intersection du mesurable et de l’interprété. C’est là que se joue la véritable décision data-informed : non pas choisir entre chiffres et récits, mais accepter que la pertinence naît de leur dialogue.
B. Éthique et responsabilité dans l’usage de la donnée
Collecter et traiter des données n’est jamais un acte neutre. Chaque indicateur que vous définissez, chaque tableau de bord que vous construisez engage une certaine vision du client, de votre marché et de votre rôle dans l’écosystème numérique. L’éthique de la data n’est donc pas une question annexe, mais une condition de légitimité : sans transparence sur la finalité de vos indicateurs et sur leur mode de construction, vous risquez de transformer vos outils de pilotage en instruments de défiance.
La gouvernance éthique commence par le choix des KPI eux-mêmes. En marketing, il est tentant de privilégier des métriques spectaculaires (volumes de données collectées, taux d’ouverture élevés, micro-segments hyper-précis) mais ces indicateurs peuvent masquer une déconnexion avec vos valeurs réelles et avec les attentes de vos parties prenantes. C’est ici que le principe responsabilité formulé par Hans Jonas prend tout son sens : décider, c’est toujours anticiper les effets futurs, visibles ou invisibles, de vos choix. Une segmentation trop intrusive peut donner des résultats immédiats, mais elle dégrade durablement la confiance de vos clients et compromet votre réputation. L’éthique de la data exige que vous assumiez non seulement l’efficacité court terme, mais aussi les conséquences à long terme de vos modèles.
Le choix éthique, comme le rappelle Kierkegaard, ne se réduit pas à l’application mécanique d’une règle. Il suppose une prise de position, une décision qui engage votre identité. Lorsque vous décidez d’abandonner un indicateur trop intrusif, ou de privilégier des KPI de confiance plutôt que des métriques de performance immédiate, vous orientez votre stratégie vers une cohérence plus profonde. C’est cette orientation, plus qu’un simple calcul, qui fonde la légitimité de vos décisions.
Nishida, enfin, éclaire la dimension structurelle de cette responsabilité. Sa notion de basho nous invite à considérer que toute décision prend place dans un « lieu » éthique, un champ relationnel qui relie l’entreprise à ses clients, à ses collaborateurs, à son environnement. En matière de gouvernance de la donnée, cela signifie que chaque indicateur doit être pensé non seulement pour son efficacité interne, mais pour sa place dans un écosystème plus large. La donnée ne peut être gouvernée de manière purement instrumentale ; elle doit être située dans un cadre qui respecte la confiance et la transparence, faute de quoi elle perd toute légitimité.
Mon article sur l’omnicanalité l’a bien montré : une stratégie de collecte et d’activation de données ne peut réussir que si elle s’accompagne d’une clarté narrative et d’un pacte explicite avec les utilisateurs. En assumant pleinement une démarche digitale cohérente avec vos valeurs, où la donnée est traitée comme un bien relationnel, un lien de confiance à préserver, et non comme une ressource exploitable à volonté, vous transformez vos métriques en instruments de crédibilité.
En définitive, l’éthique de la donnée n’est pas une contrainte extérieure à vos modèles de pilotage : elle en est la condition de validité. La véritable responsabilité décisionnelle consiste à gouverner vos données comme des engagements : non pas seulement des chiffres à analyser, mais des promesses tenues envers vos clients, vos équipes et votre marché.
C. Construire une culture de discernement et de jugement stratégique
Une gouvernance des données ne se résume pas à la mise en place de dashboards performants ni à la définition de KPI précis. Elle exige l’installation d’une culture de l’information, où vos équipes apprennent à interpréter, à questionner et à orienter les chiffres au service d’une vision collective et de long terme. Sans cette culture, même les indicateurs les plus sophistiqués se réduisent à des fragments isolés, incapables de soutenir une véritable stratégie.
Cette culture suppose de dépasser la logique de l’optimisation immédiate pour inscrire chaque choix dans une trajectoire cohérente. C’est ce qu’Aristote appelait la phronèsis, cette prudence pratique qui articule les moyens et les fins. Mais cette prudence n’est pas une pruderie de calcul : elle suppose, comme le souligne Kierkegaard, une répétition signifiante, c’est-à-dire la capacité de rejouer dans des contextes nouveaux l’intention fondatrice qui guide vos décisions. En entreprise, cela signifie que vos équipes ne doivent pas se contenter d’appliquer des protocoles figés : elles doivent réinterpréter vos principes stratégiques à la lumière de nouvelles données, de nouveaux usages, de nouvelles attentes.
Pour que cette répétition ait un sens, elle doit s’inscrire dans un cadre commun. Nishida l’appelle basho : un lieu partagé qui relie les interprétations individuelles et leur donne cohérence. Sans ce lieu, chaque département lit les chiffres à sa manière, chaque équipe poursuit ses propres objectifs, et la gouvernance se fragmente. Une culture numérique en entreprise se reconnaît précisément à l’inverse : elle ne consomme pas des outils comme des gadgets isolés, mais elle organise un cadre où la donnée est interprétée dans une logique collective et orientée vers une finalité partagée.
La philosophie du dashboard exprime bien cette exigence : un tableau de bord efficace n’est pas un agrégat d’indicateurs, mais une scène où se construisent mémoire, contexte et orientation. La prudence aristotélicienne, la reprise kierkegaardienne et le basho de Nishida convergent ici : juger une donnée, c’est toujours la replacer dans une finalité commune, la relier à une mémoire vivante et l’inscrire dans un lieu collectif qui garantit sa légitimité.
Ainsi, construire une culture de discernement ne consiste pas à multiplier les métriques ni à perfectionner vos outils, mais à former vos équipes à lire les données comme des fragments d’un récit partagé. C’est cette dynamique de mémoire, de finalité et de lieu qui transforme l’information en gouvernance stratégique : non plus une collection de chiffres, mais une intelligence collective capable d’orienter et de durer.
En définitive, la gouvernance éclairée de la donnée repose moins sur la précision des outils que sur la capacité collective à en faire un lieu de discernement. Croiser quantitatif et qualitatif, assumer la responsabilité des indicateurs choisis et installer une culture de jugement partagé : c’est dans cette triple exigence que vos données cessent d’être des fragments dispersés pour devenir une intelligence stratégique vivante.
Conclusion
Nous avons posé la question suivante : dans un contexte où la culture data-driven s’impose comme norme, comment éviter que l’entreprise ne se perde dans l’illusion d’objectivité des chiffres ? L’analyse l’a montré : la donnée est un outil puissant, mais elle ne suffit pas. Sans interprétation, sans discernement et sans mise en récit, elle n’est qu’un fragment inerte, incapable d’éclairer vos décisions. C’est pourquoi la véritable maturité ne consiste pas à être data-driven, mais à devenir data-informed : orienter vos choix en combinant la rigueur quantitative et l’intelligence qualitative, en assumant la responsabilité des indicateurs choisis et en construisant une culture de jugement collectif.
L’avenir du pilotage stratégique se trouve dans cette éthique de la donnée : savoir que chaque chiffre est un engagement, qu’il doit être replacé dans une vision, et qu’il appelle un discernement constant. Ce n’est pas la donnée qui décide, c’est la manière dont vous la gouvernez qui fonde votre avantage.
—
Pour transformer vos données en véritable avantage concurrentiel, prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec Richard Bulan et découvrez l’offre Eidôlon.
FAQ
Une approche data-driven consiste à laisser les chiffres orienter directement les décisions. À l’inverse, une approche data-informed intègre les données comme appuis, tout en les confrontant au contexte, à l’expérience et au jugement stratégique.
Parce qu’ils sont toujours partiels et construits. Un KPI peut refléter une tendance locale ou un biais méthodologique sans traduire la réalité profonde de vos clients ou de votre marché. Leur valeur dépend de leur mise en contexte.
L’OSINT qualitatif permet de capter des signaux faibles, d’analyser des récits et de donner une profondeur interprétative aux données brutes. C’est cette hybridation entre quantitatif et qualitatif qui fait émerger une intelligence exploitable.
En dépassant l’usage technique des outils pour développer une culture partagée : former vos équipes à interpréter les données, relier chaque indicateur à une finalité stratégique et instaurer un cadre collectif de lecture (dashboards narratifs, comités transverses, gouvernance claire).
Parce qu’elle construit la confiance : clients, collaborateurs et partenaires adhèrent davantage à vos décisions lorsque vos métriques traduisent transparence, finalité claire et respect des usages. Cette confiance devient un actif stratégique durable.